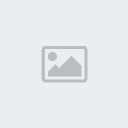Ecriture de l'exil
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2 
Se résoudre à l'exil pour...?
 Ecriture de l'exil
Ecriture de l'exil
Yoko Tawada: Le corps de la langue- Le voyage à Bordeaux

Yoko Tawada et Sigrid Weigel ( directrice du "Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin"/ centre de recherche littéraire et culturel, Berlin)
Romancière japonaise écrivant alternativement en allemand et en japonais, sans jamais se traduire elle-même d’une langue à l’autre, Yoko Tawada ne cesse de traquer le mystère de la différence des langues et des civilisations, dans un va-et-vient constant entre Orient et Occident.
Elle pratique "l'ecriture au pinceau", expression qui montre son écoute, elle se met pour l'ecriture à la disponibilité de la langue.
Ainsi d'une idée en japonais peuvent naître deux récits différents selon qu'ils seront ecrits en allemand ou en japonais.
Je ne peux m'empêcher de rapprocher sa quête du langage universel, avec ce que Daniel Tammet (atteint d'une forme particulière d'autisme, appelée syndrôme d'Asperger) explique de la manière dont il appréhende toutes les langues, à travers les couleurs et les vibrations qu'elles évoquent en lui, et qui lui permettent de mémoriser les mots, dans son ouvrage "Je suis né un jour bleu" ...
Tawada rêve d'une écriture en 3 D où on caresserait les mots comme un corps.
Son rêve pourrait devenir réalité, puisque Tammet lit et entend les mots (ainsi que les chiffres ) en les visualisant par une forme, avec une texture, un mouvement, et une couleur à travers des émotions poétiques; ces représentations mentales s'imposant à lui dans l'immédiateté ... les neuroscientifiques le qualifient d'ailleurs de "Pierre de Rosette" du langage universel, en tentant de décrypter son système inné d'appréhension du langage ...
Yoko Tawada explore le monde de l’entre-deux, qui est très manifeste dans son oeuvre Le Voyage à Bordeaux que je voudrais présenter ici.
- entre deux langues, la jeune Japonaise est à Hambourg et juxtapose dans son livre l’idéogramme et les mots qu’elle entend,
- entre deux lieux, puisque de Hambourg elle pense à Bordeaux et qu’à Bordeaux elle revit des souvenirs de Hambourg.
Présentation de l'oeuvre: Le Voyage à Bordeaux

Toute son oeuvre est basée sur cet aller-retour entre deux langues. Comment appréhender le monde avec l'apprentissage des langues ? Ou encore aller vers l'inconnu pour mieux se connaître...Tels pourraient être les adages de ce curieux récit : le double de l'écrivain, Yunna, décide d'aller en France grâce à un surprenant mensonge : elle fait croire à une conférencière spécialiste de Phèdre qu'elle souhaite monter Racine en théâtre de Nô. Cette dernière lui propose donc de rejoindre Maurice, son beau-frère à Bordeaux...
La timide étudiante japonaise Yuna quitte Hambourg pour se rendre à Bordeaux afin d'y étudier le français. Elle séjournera dans la maison de Maurice, beau-frère d'une de ses amies universitaires. Ce voyage en train et les premiers temps passés dans la ville de Montaigne ravivent les souvenirs d'amis vivants ou disparus. Mais il est aussi et surtout une quête d'accomplissement de soi, dans la plus grande tradition du Bildungsroman, le roman de formation, dont la référence reste sans aucun doute Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe.
Commence donc alors un apprentissage loufoque tirant sur le fantastique : la langue devient obstacle, on apprend la langue vainement sans forcément chercher à décrypter le monde ; on joue sur les mots, on invente des expressions, ce qui crée un curieux vertige.
Tawada choisit la forme du fragment qui fait surgir des souvenirs et des associations d'idées : à chaque début de paragraphe, elle place un idéogramme japonais qu'elle ne traduit pas, comme autant de signes qu'il faut "désentortiller" comme elle le dit. Les rencontres sont furtives, les personnages sont très vaporeux.
Certains épisodes frisent avec le fantastique comme cette maison bordelaise qui agresse son occupante où cette scène magnifique dans une piscine où Yunna se fait dérober son dictionnaire et sa date de naissance...
C’est l’étonnement de l’exil, devant des moeurs et des mots nouveaux, la sensation d’un présent plus étranger que le passé révolu, et la nécessaire conversion à établir :
Les noms des entreprises coréennes ne figuraient ni en écriture coréenne, ni en idéogrammes, mais en alphabet latin.
Aujourd’hui est-il toujours ici ? Et qu’y a-t-il entre hier et aujourd’hui ? D’aucunes affirmeraient qu’entre ici et là- bas et il y a une nuit. Donc une autre Yuna, restée là-bas devait continuer de vire par delà la nuit.. Ainsi à chaque voyage de nuit, elle se multipliait, et dans chaque espace de temps il demeurait un exemplaire de la même personne.
Née au Japon, elle avait respiré dès l’enfance l’air de divers pays car son père était diplomate. Une carte de soins du corps humain était accrochée au mur de sa salle de soins. Ce corps n’était ni celui d’un homme ni d’une femme. La peau était couverte de nombreux idéogrammes
Yuna avait passé bien des années de sa jeunesse dans une cellule, dans l’une des cellules de sa tête, avec constamment sous es yeux des pages des livres aux lignes verticales comme des barreaux.
Elle s’attache à décrypter tout ce qu’elle voit et entend, à le « désentortiller », à le transformer en interprétant les signes selon sa culture métissée.
Tout devient signe, ainsi une vitrine de mangas,
Des broches d’argent en forme de crochet ou d’épingle, des bâtonnets d’encens en sachets imprimés d’idéogrammes fantaisistes.
Ou un corps couvert d’idéogrammes. L’esprit s’envole et devient créateur, comme pendant son enfance :
Elle trouva un mot au milieu duquel ondoyait la lettre m. Ces dos des vagues arrondies n’étaient pas dessinés de manière réaliste, elle les connaissait par les peintures qui ornaient les murs de son école maternelle. A l’époque elle ne savait pas encore vraiment écrire,, ou plutôt si, elle savait déjà lire et écrire de nombre de signes, elle en inventait sans cesse de nouveaux et ne savait pas encore distinguer ceux qu’elle apprenait de ceux qu’elle inventait.
Dans ce cinquième roman traduit en francais aux éditions Verdier, Yoko Tawada s'est trouvée un double en la personne de Yuna. Elle a en effet passé de nombreuses années elle-même à Hambourg avant de s'installer en 2006, à Berlin. L'auteur, qui écrit tour à tour en japonais et en allemand montre ici comment la quête d'altérité est liée à l'apprentissage d'une langue universelle, seule clef permettant l'accès à l'intime.
« Pourquoi apprendre des langues étrangères ? Apprendre, à l'époque, c'était presque toujours apprendre une langue. Que pouvait-on apprendre d'autre ? On apprenait la langue des autres, la langue des baleines, celle des machines, celle de l'anatomie, et aussi celle des fleurs de jardin. Personne ne demandait à Yuna ce qu'elle comptait faire plus tard de cette nouvelle langue apprise. On n'offrait rien à faire de particulier avec la langue, mais c'était la langue elle-même qui marquait les buts. A l'époque, les professeurs de Yuna partaient du principe que c'était la langue qui avait façonné elle-même les vis de la fusée Spoutnik. »
Un idéogramme non traduit marque le début de chaque nouveau paragraphe, laissant le lecteur non japonisant ni sinisant – la grande majorité des kanjis sont d'origine chinoise – un brin démuni. A moins qu'il ne s'agisse-là d'une volonté délibérée de Yoko Tawada de montrer la difficulté de sa quête en nous obligeant à plonger dans le silence de l'incommunicabilité.
Il faudra attendre les toutes dernières lignes de ce livre qui s'achève dans une piscine pour comprendre que ce voyage sans fin prend à chaque fois une autre direction. La quête n'est donc finie. Yuna progresse dans l'accomplissement de soi. Les portes s'ouvrent sur un nouvel horizon. Elle finira peut-être par se « mouiller » davantage.
Extrait du livre
企
Jusque-là, Yuna n’avait jamais joué sous le toit d’un théâtre ou, comme on disait généralement à Hambourg, sur une scène. Elle n’avait jamais échangé un mot avec des gens de théâtre, si tant est qu’il y ait une sorte de gens qu’on puisse qualifier de gens de théâtre. Le bruit de l’existence de ces prétendus gens de théâtre était parvenu aux oreilles de Yuna pour la première fois par la bouche d’Ingrid. La future héritière originaire de Blankenese parlait encore à l’époque d’un Italien qui était de ces gens de théâtre et s’était dit prêt à monter ses pièces au cas où elle en écrirait. Parmi ses amis, nul ne savait si elle en avait seulement commencé une. Toujours est-il que, le jour où elle hérita d’une maison, cette pièce de théâtre commencée un jour, ou jamais commencée du tout, fut mise au panier. On n’écrit pas de pièce quand on sait qu’un jour ou l’autre on va hériter, avait déclaré l’une de ses amies.
Renée dévisageait avec curiosité l’étudiante aux joues rouges qui parlait de gens de théâtre ou de son souhait d’entrer en contact avec eux. Renée ne savait pas non plus ce qu’étaient des gens de théâtre, mais elle proposa quand même tout de suite à Yuna d’aller boire un café avec elle pour discuter plus en détail de ce projet.
夢
Le rêve de Yuna était de devenir comédienne et de dire son texte en langue étrangère. C’était un rêve puisqu’elle avait souvent rêvé qu’elle se tenait sur une scène et récitait un long monologue en une langue inconnue d’elle. Elle portait sur la tête une couronne d’herbe et savait que la couronne n’était pas en lauriers tressés, mais en fleurs de pensées.
Des phrases étrangères coulaient en elle et s’écoulaient d’elle. Après chaque phrase Yuna avait peur de ne plus pouvoir parler. Or il suffisait qu’elle garde son crâne ouvert pour permettre aux phrases d’y couler. Était-elle toujours éveillée ou déjà en train de perdre connaissance ? Yuna n’en savait rien. Elle avait la chair de poule, la partie inférieure de son ventre était brûlante et tremblante.
嘘
Les deux femmes étaient assises à la terrasse d’un café. Mon rêve est de devenir comédienne, avait dit Yuna à Renée en pensant qu’un cauchemar aussi est un rêve, peut-être le rêve entre tous les rêves. Renée avait demandé, étonnée : Ce qui veut dire que vous n’êtes pas encore comédienne ? Yuna avait rougi, toussé et ouvert son sac à dos bien qu’elle n’eût rien du tout à en sortir. Yuna n’aurait pas eu à avoir mauvaise conscience si elle avait su à ce moment-là qu’il arrivait souvent à Renée de mentir. Renée ne mentait pas explicitement, mais il lui arrivait souvent de passer sous silence l’embonpoint pour insister en contrepartie sur la ceinture. Elle disait par exemple que son père était du genre artiste mais ne révélait jamais quel métier avait été le sien en réalité.

Yoko Tawada et Sigrid Weigel, Université Von Humbold, Berlin

Yoko Tawada et Sigrid Weigel ( directrice du "Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin"/ centre de recherche littéraire et culturel, Berlin)
Romancière japonaise écrivant alternativement en allemand et en japonais, sans jamais se traduire elle-même d’une langue à l’autre, Yoko Tawada ne cesse de traquer le mystère de la différence des langues et des civilisations, dans un va-et-vient constant entre Orient et Occident.
Elle pratique "l'ecriture au pinceau", expression qui montre son écoute, elle se met pour l'ecriture à la disponibilité de la langue.
Ainsi d'une idée en japonais peuvent naître deux récits différents selon qu'ils seront ecrits en allemand ou en japonais.
Je ne peux m'empêcher de rapprocher sa quête du langage universel, avec ce que Daniel Tammet (atteint d'une forme particulière d'autisme, appelée syndrôme d'Asperger) explique de la manière dont il appréhende toutes les langues, à travers les couleurs et les vibrations qu'elles évoquent en lui, et qui lui permettent de mémoriser les mots, dans son ouvrage "Je suis né un jour bleu" ...
Tawada rêve d'une écriture en 3 D où on caresserait les mots comme un corps.
Son rêve pourrait devenir réalité, puisque Tammet lit et entend les mots (ainsi que les chiffres ) en les visualisant par une forme, avec une texture, un mouvement, et une couleur à travers des émotions poétiques; ces représentations mentales s'imposant à lui dans l'immédiateté ... les neuroscientifiques le qualifient d'ailleurs de "Pierre de Rosette" du langage universel, en tentant de décrypter son système inné d'appréhension du langage ...
Yoko Tawada explore le monde de l’entre-deux, qui est très manifeste dans son oeuvre Le Voyage à Bordeaux que je voudrais présenter ici.
- entre deux langues, la jeune Japonaise est à Hambourg et juxtapose dans son livre l’idéogramme et les mots qu’elle entend,
- entre deux lieux, puisque de Hambourg elle pense à Bordeaux et qu’à Bordeaux elle revit des souvenirs de Hambourg.
Présentation de l'oeuvre: Le Voyage à Bordeaux

Toute son oeuvre est basée sur cet aller-retour entre deux langues. Comment appréhender le monde avec l'apprentissage des langues ? Ou encore aller vers l'inconnu pour mieux se connaître...Tels pourraient être les adages de ce curieux récit : le double de l'écrivain, Yunna, décide d'aller en France grâce à un surprenant mensonge : elle fait croire à une conférencière spécialiste de Phèdre qu'elle souhaite monter Racine en théâtre de Nô. Cette dernière lui propose donc de rejoindre Maurice, son beau-frère à Bordeaux...
La timide étudiante japonaise Yuna quitte Hambourg pour se rendre à Bordeaux afin d'y étudier le français. Elle séjournera dans la maison de Maurice, beau-frère d'une de ses amies universitaires. Ce voyage en train et les premiers temps passés dans la ville de Montaigne ravivent les souvenirs d'amis vivants ou disparus. Mais il est aussi et surtout une quête d'accomplissement de soi, dans la plus grande tradition du Bildungsroman, le roman de formation, dont la référence reste sans aucun doute Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe.
Commence donc alors un apprentissage loufoque tirant sur le fantastique : la langue devient obstacle, on apprend la langue vainement sans forcément chercher à décrypter le monde ; on joue sur les mots, on invente des expressions, ce qui crée un curieux vertige.
Tawada choisit la forme du fragment qui fait surgir des souvenirs et des associations d'idées : à chaque début de paragraphe, elle place un idéogramme japonais qu'elle ne traduit pas, comme autant de signes qu'il faut "désentortiller" comme elle le dit. Les rencontres sont furtives, les personnages sont très vaporeux.
Certains épisodes frisent avec le fantastique comme cette maison bordelaise qui agresse son occupante où cette scène magnifique dans une piscine où Yunna se fait dérober son dictionnaire et sa date de naissance...
C’est l’étonnement de l’exil, devant des moeurs et des mots nouveaux, la sensation d’un présent plus étranger que le passé révolu, et la nécessaire conversion à établir :
Les noms des entreprises coréennes ne figuraient ni en écriture coréenne, ni en idéogrammes, mais en alphabet latin.
Aujourd’hui est-il toujours ici ? Et qu’y a-t-il entre hier et aujourd’hui ? D’aucunes affirmeraient qu’entre ici et là- bas et il y a une nuit. Donc une autre Yuna, restée là-bas devait continuer de vire par delà la nuit.. Ainsi à chaque voyage de nuit, elle se multipliait, et dans chaque espace de temps il demeurait un exemplaire de la même personne.
Née au Japon, elle avait respiré dès l’enfance l’air de divers pays car son père était diplomate. Une carte de soins du corps humain était accrochée au mur de sa salle de soins. Ce corps n’était ni celui d’un homme ni d’une femme. La peau était couverte de nombreux idéogrammes
Yuna avait passé bien des années de sa jeunesse dans une cellule, dans l’une des cellules de sa tête, avec constamment sous es yeux des pages des livres aux lignes verticales comme des barreaux.
Elle s’attache à décrypter tout ce qu’elle voit et entend, à le « désentortiller », à le transformer en interprétant les signes selon sa culture métissée.
Tout devient signe, ainsi une vitrine de mangas,
Des broches d’argent en forme de crochet ou d’épingle, des bâtonnets d’encens en sachets imprimés d’idéogrammes fantaisistes.
Ou un corps couvert d’idéogrammes. L’esprit s’envole et devient créateur, comme pendant son enfance :
Elle trouva un mot au milieu duquel ondoyait la lettre m. Ces dos des vagues arrondies n’étaient pas dessinés de manière réaliste, elle les connaissait par les peintures qui ornaient les murs de son école maternelle. A l’époque elle ne savait pas encore vraiment écrire,, ou plutôt si, elle savait déjà lire et écrire de nombre de signes, elle en inventait sans cesse de nouveaux et ne savait pas encore distinguer ceux qu’elle apprenait de ceux qu’elle inventait.
Dans ce cinquième roman traduit en francais aux éditions Verdier, Yoko Tawada s'est trouvée un double en la personne de Yuna. Elle a en effet passé de nombreuses années elle-même à Hambourg avant de s'installer en 2006, à Berlin. L'auteur, qui écrit tour à tour en japonais et en allemand montre ici comment la quête d'altérité est liée à l'apprentissage d'une langue universelle, seule clef permettant l'accès à l'intime.
« Pourquoi apprendre des langues étrangères ? Apprendre, à l'époque, c'était presque toujours apprendre une langue. Que pouvait-on apprendre d'autre ? On apprenait la langue des autres, la langue des baleines, celle des machines, celle de l'anatomie, et aussi celle des fleurs de jardin. Personne ne demandait à Yuna ce qu'elle comptait faire plus tard de cette nouvelle langue apprise. On n'offrait rien à faire de particulier avec la langue, mais c'était la langue elle-même qui marquait les buts. A l'époque, les professeurs de Yuna partaient du principe que c'était la langue qui avait façonné elle-même les vis de la fusée Spoutnik. »
Un idéogramme non traduit marque le début de chaque nouveau paragraphe, laissant le lecteur non japonisant ni sinisant – la grande majorité des kanjis sont d'origine chinoise – un brin démuni. A moins qu'il ne s'agisse-là d'une volonté délibérée de Yoko Tawada de montrer la difficulté de sa quête en nous obligeant à plonger dans le silence de l'incommunicabilité.
Il faudra attendre les toutes dernières lignes de ce livre qui s'achève dans une piscine pour comprendre que ce voyage sans fin prend à chaque fois une autre direction. La quête n'est donc finie. Yuna progresse dans l'accomplissement de soi. Les portes s'ouvrent sur un nouvel horizon. Elle finira peut-être par se « mouiller » davantage.
Extrait du livre
企
Jusque-là, Yuna n’avait jamais joué sous le toit d’un théâtre ou, comme on disait généralement à Hambourg, sur une scène. Elle n’avait jamais échangé un mot avec des gens de théâtre, si tant est qu’il y ait une sorte de gens qu’on puisse qualifier de gens de théâtre. Le bruit de l’existence de ces prétendus gens de théâtre était parvenu aux oreilles de Yuna pour la première fois par la bouche d’Ingrid. La future héritière originaire de Blankenese parlait encore à l’époque d’un Italien qui était de ces gens de théâtre et s’était dit prêt à monter ses pièces au cas où elle en écrirait. Parmi ses amis, nul ne savait si elle en avait seulement commencé une. Toujours est-il que, le jour où elle hérita d’une maison, cette pièce de théâtre commencée un jour, ou jamais commencée du tout, fut mise au panier. On n’écrit pas de pièce quand on sait qu’un jour ou l’autre on va hériter, avait déclaré l’une de ses amies.
Renée dévisageait avec curiosité l’étudiante aux joues rouges qui parlait de gens de théâtre ou de son souhait d’entrer en contact avec eux. Renée ne savait pas non plus ce qu’étaient des gens de théâtre, mais elle proposa quand même tout de suite à Yuna d’aller boire un café avec elle pour discuter plus en détail de ce projet.
夢
Le rêve de Yuna était de devenir comédienne et de dire son texte en langue étrangère. C’était un rêve puisqu’elle avait souvent rêvé qu’elle se tenait sur une scène et récitait un long monologue en une langue inconnue d’elle. Elle portait sur la tête une couronne d’herbe et savait que la couronne n’était pas en lauriers tressés, mais en fleurs de pensées.
Des phrases étrangères coulaient en elle et s’écoulaient d’elle. Après chaque phrase Yuna avait peur de ne plus pouvoir parler. Or il suffisait qu’elle garde son crâne ouvert pour permettre aux phrases d’y couler. Était-elle toujours éveillée ou déjà en train de perdre connaissance ? Yuna n’en savait rien. Elle avait la chair de poule, la partie inférieure de son ventre était brûlante et tremblante.
嘘
Les deux femmes étaient assises à la terrasse d’un café. Mon rêve est de devenir comédienne, avait dit Yuna à Renée en pensant qu’un cauchemar aussi est un rêve, peut-être le rêve entre tous les rêves. Renée avait demandé, étonnée : Ce qui veut dire que vous n’êtes pas encore comédienne ? Yuna avait rougi, toussé et ouvert son sac à dos bien qu’elle n’eût rien du tout à en sortir. Yuna n’aurait pas eu à avoir mauvaise conscience si elle avait su à ce moment-là qu’il arrivait souvent à Renée de mentir. Renée ne mentait pas explicitement, mais il lui arrivait souvent de passer sous silence l’embonpoint pour insister en contrepartie sur la ceinture. Elle disait par exemple que son père était du genre artiste mais ne révélait jamais quel métier avait été le sien en réalité.

Yoko Tawada et Sigrid Weigel, Université Von Humbold, Berlin
Dernière édition par Enigma le Mar 17 Aoû 2010 - 12:05, édité 2 fois
Invité- Invité
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Intrigant...Certains épisodes frisent avec le fantastique comme cette maison bordelaise qui agresse son occupante où cette scène magnifique dans une piscine où Yunna se fait dérober son dictionnaire et sa date de naissance...
J'aime cette idée de cerveau qui emprisonne.
Yuna avait passé bien des années de sa jeunesse dans une cellule, dans l’une des cellules de sa tête, avec constamment sous les yeux des pages des livres aux lignes verticales comme des barreaux.
La forme au service de ce qu'elle veut démontrer... Habile.
Un idéogramme non traduit marque le début de chaque nouveau paragraphe, laissant le lecteur non japonisant ni sinisant – la grande majorité des kanjis sont d'origine chinoise – un brin démuni. A moins qu'il ne s'agisse-là d'une volonté délibérée de Yoko Twada de montrer la difficulté de sa quête en nous obligeant à plonger dans le silence de l'incommunicabilité.
Le principe du fragment, d'après les extraits que tu donnes à lire, renforce l'impression poétique. Les fleurs de pensées, le crâne qui laisse s'écouler la langue... Il semble y avoir des surgissements d'images.
Merci pour cette belle et complète présentation!
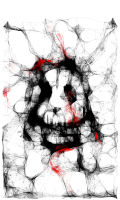
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
Invité- Invité
 écriture fragmentaire ou le corps de la langue déconstruit chez Tawada
écriture fragmentaire ou le corps de la langue déconstruit chez Tawada
Kashima, en effet, intriguant...Tawada est une personne intriguante, femme d'Esprit, avec énormément d'ironie. Elle jongle entre les langues avec une dextérité incroyable!
J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois à Hambourg et à Berlin. Elle m'a séduite tout de suite: sa modestie, sa simplicité et son intelligence...Charismatique est vraiment le terme qui la définirait le mieux.
Sa "langue" est aussi intrigante et dé-routante ( que j'entends littéralement).
Elle met en effet, la forme au service de ce qu'elle veut démontrer. Son écriture est bel et bien fragmentaire et en cela, elle s'inscrit dans la lignée des déconstructivistes: Derrida, Cixoux, Kristeva....
Ce corps de la langue est si symboloque pour tous les écrivains de l'exil.
Quitter son pays, pour les écrivains de l'exil signifie littérallement mort symbolique et renaissance.
Ce n'est pas par hasard si Kristeva ( sur qui je m'attarderai prochainement) en parle comme de la mort d'un corps maternel- et de sa résurection en tant qu' "autre".
Tout comme le corps maternel- c-à-d "la terre-mère"- leur langue maternelle est mise à mort.
Tawada, contrairement à Brodsky, Kristeva ou Cioran a gardé "sa" langue puisqu'elle est un écrivain bilingue.
Comme Beckett et Federman, Tawada a gardé sa langue maternelle, tout en faisant sienne la langue du pays adopté.
Enfin, on pourrait parler de cas où la langue maternelle arrive à mettre son empreinte sur la deuxième langue à l'insu de l'écrivain, créant ainsi une langue hybride involontaire. Je pense ici au poète Ilya Kaminsky, jeune poète américain, d'origine russe, considéré comme l'un des poètes les plus prometteurs des nouvelles générations.
Si Federman se disait francais et américain, Beckett affirmait n'être ni irlandais ni francais.
Pourtant, Beckett approuverait certainement les mots de Federman lorsque celui-ci compare, son passage du francais à l'anglais à une libération:
"En francais je me sens tel un prisonnier, probablement parce que le francais m'a fait, parce qu'il m'a saisi à l'origine, alors qu'en anglais je me sens libre, puisqu'il m'a libéré, puisqu'il m'a permis de sortir hors de la langue et de la culture francaise."
La coexistence de 2 langues, dépourvues d'un original est matérialisé dans le livre de Federman: , où 2 textes sont littéralement imprimés l'un à côté de l'autre, mais à l'envers. ( Ce qui fait penser à la méthode déconstructiviste de Derrida dont je t'avais déjà parlée)....Comment mieux rendre "le corps de la langue"?
J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois à Hambourg et à Berlin. Elle m'a séduite tout de suite: sa modestie, sa simplicité et son intelligence...Charismatique est vraiment le terme qui la définirait le mieux.
Sa "langue" est aussi intrigante et dé-routante ( que j'entends littéralement).
Elle met en effet, la forme au service de ce qu'elle veut démontrer. Son écriture est bel et bien fragmentaire et en cela, elle s'inscrit dans la lignée des déconstructivistes: Derrida, Cixoux, Kristeva....
Ce corps de la langue est si symboloque pour tous les écrivains de l'exil.
Quitter son pays, pour les écrivains de l'exil signifie littérallement mort symbolique et renaissance.
Ce n'est pas par hasard si Kristeva ( sur qui je m'attarderai prochainement) en parle comme de la mort d'un corps maternel- et de sa résurection en tant qu' "autre".
Tout comme le corps maternel- c-à-d "la terre-mère"- leur langue maternelle est mise à mort.
Tawada, contrairement à Brodsky, Kristeva ou Cioran a gardé "sa" langue puisqu'elle est un écrivain bilingue.
Comme Beckett et Federman, Tawada a gardé sa langue maternelle, tout en faisant sienne la langue du pays adopté.
Enfin, on pourrait parler de cas où la langue maternelle arrive à mettre son empreinte sur la deuxième langue à l'insu de l'écrivain, créant ainsi une langue hybride involontaire. Je pense ici au poète Ilya Kaminsky, jeune poète américain, d'origine russe, considéré comme l'un des poètes les plus prometteurs des nouvelles générations.
Si Federman se disait francais et américain, Beckett affirmait n'être ni irlandais ni francais.
Pourtant, Beckett approuverait certainement les mots de Federman lorsque celui-ci compare, son passage du francais à l'anglais à une libération:
"En francais je me sens tel un prisonnier, probablement parce que le francais m'a fait, parce qu'il m'a saisi à l'origine, alors qu'en anglais je me sens libre, puisqu'il m'a libéré, puisqu'il m'a permis de sortir hors de la langue et de la culture francaise."
La coexistence de 2 langues, dépourvues d'un original est matérialisé dans le livre de Federman: , où 2 textes sont littéralement imprimés l'un à côté de l'autre, mais à l'envers. ( Ce qui fait penser à la méthode déconstructiviste de Derrida dont je t'avais déjà parlée)....Comment mieux rendre "le corps de la langue"?
Invité- Invité
 le corps de la langue dans sa pluralité...effet boomerang?
le corps de la langue dans sa pluralité...effet boomerang?
Oh Verbatim, moi qui m'attendais à une nouvelle critique/ attaque de ta part...m'en voilà fort flattée:-)
Mon article précédent: Makine-Tawada: trans-écriture/ lecture n'était concu que comme une propédeutique.
Avec ou sans ta critique, j'aurais développé, de toute facon, car la littérature de l'exil et toute la problématique de la langue/ des langues est en quelque sorte "mon" histoire.
Comme Tawada, je suis russophile et parle le russe et ai entretenu tout comme elle, dès ma tendre enfance, une relation "particulière" avec la "Mère" Russie. Le japonais, je le parle couremment sans malheureusement, le maîtriser vraiment à l'écrit.
Et comme elle, je connais l'exil et jongle en permanence entre le francais et l'allemand....A une certaine époque russe/ francais/ allemand/ japonais...
Mais je te l'accorde, il y a toujours une langue "dominante" qui n'est pas obligatoirement la langue maternelle. Ma langue "maternelle" est le francais mais je m'exprime mieux en allemand.
Et si je devais citer un seul exemple, d'un écrivain qui maîtrisait plusieurs langues et qui s'est exilé dans UNE langue étrangère ( l'allemand) et la fait sienne...auteur- de langue allemande- qui fut récompensé par le Prix Nobel: ELIAS CANETTI et si je ne devais citer qu'une oeuvre de Canetti, ce serait son oeuvre autobiographique La langue sauvée
Elias Canetti, dans ce livre, évoque sa jeunesse et plus particulièrement ses souvenirs d’enfance entre 1905 et 1921. Il nous livre ici le récit de son éducation qu’il recoit en Europe Centrale au début du siècle, dans une époque encore insouciante et joyeuse, avant que l’Occident ne soit emporté dans les déflagrations de la Grande Guerre en 1914. Avec beaucoup de sensibilité, il évoque fidèlement ses premiers souvenirs, ses joies et ses peines alors qu’il coulait encore des jours heureux au bord du Danube.
Une bonne illustration de la "langue sauvée" - l'allemand, que sa mère lui avait appris ( et comment! avec tyrannie! Comment ne pas avoir été dégoûté de l'allemand après?!), par amour de la Vienne impériale, et qui représentait à leurs yeux le haut lieu de la culture européenne.
Je te cite un passage de cette oeuvre qui m'a fort marquée :
"L’apprentissage de l’allemand au bord du lac de Genève ( Genève, un clien d'oeil pour toi Kashima, Ton Never(s)...Hiroshima sans amour:-)
J’avais huit ans, je devais aller à l’école à Vienne et notamment entrer dans la 3ème classe de la Volksschule, qui correspondait à mon âge. C’était une pensée insupportable pour ma mère qu’on puisse me refuser l’entrée dans cette classe pour le motif que je ne connaisse pas la langue, et aussi, était-elle décidée à me faire apprendre l’allemand dans les plus brefs délais.
C’est ainsi que peu de temps après notre arrivée, nous nous rendîmes dans une librairie. Ma mère demanda une grammaire anglo-allemande, prit le premier livre qu'on lui donna, me ramena immédiatement à la maison et commença sa leçon.
[…]
Nous nous assîmes dans la salle à manger à la grande table. Je me tenais du côté le plus étroit, de sorte que je pouvais voir le lac, et les bateaux à voiles. Elle se tenait dans le coin, à ma gauche et tenait le livre de telle façon que je ne pouvais rien voir à l’intérieur. Elle le tenait toujours loin de moi. « Tu n’en n’as pas besoin », disait-elle, « de toutes façons, tu ne peux encore rien comprendre ». Mais malgré ces arguments, j’éprouvais le sentiment qu’elle me privait du livre comme d’un secret. Elle me lisait une phrase en allemand et me la faisait répéter. Comme ma prononciation la choquait, je devais la répéter plusieurs fois, jusqu’à ce que la phrase lui fut acceptable. Mais cela n’était pas souvent le cas, et comme pour rien au monde, je ne voulais supporter sa dérision, je me donnais de la peine et parlais bientôt correctement. Alors seulement, elle me disait ce que la phrase signifiait en anglais. Cependant, elle ne la répétait jamais et je devais la retenir une fois pour toutes. Elle passait alors à une autre phrase et c’était la même démarche : dès que j’avais prononcé correctement, elle traduisait la phrase, me regardait d’un air dictatorial, dont je me souviens très bien, et passait à la suivante.
Je ne sais pas combien de phrases, elle m’avait demandé la première fois. Disons, pour être modéré, quelques unes. Mais je crains qu’elle étaient nombreuses, en fait.
Elle me congédiait et me disait : « répète cela pour toi. Tu ne dois oublier aucune phrase. Pas même une seule. Demain nous continuerons ». Elle gardait le livre et je me retrouvais seul dans mon embarras.
Je n’avais aucune aide, Miss Bray ne parlait qu’anglais, et pendant la journée, ma mère refusait de me prononcer les phrases. Le jour suivant, j’étais assis à la même place, la fenêtre ouverte devant moi, avec le lac et les bateaux à voiles."
Mon article précédent: Makine-Tawada: trans-écriture/ lecture n'était concu que comme une propédeutique.
Avec ou sans ta critique, j'aurais développé, de toute facon, car la littérature de l'exil et toute la problématique de la langue/ des langues est en quelque sorte "mon" histoire.
Comme Tawada, je suis russophile et parle le russe et ai entretenu tout comme elle, dès ma tendre enfance, une relation "particulière" avec la "Mère" Russie. Le japonais, je le parle couremment sans malheureusement, le maîtriser vraiment à l'écrit.
Et comme elle, je connais l'exil et jongle en permanence entre le francais et l'allemand....A une certaine époque russe/ francais/ allemand/ japonais...
Mais je te l'accorde, il y a toujours une langue "dominante" qui n'est pas obligatoirement la langue maternelle. Ma langue "maternelle" est le francais mais je m'exprime mieux en allemand.
Et si je devais citer un seul exemple, d'un écrivain qui maîtrisait plusieurs langues et qui s'est exilé dans UNE langue étrangère ( l'allemand) et la fait sienne...auteur- de langue allemande- qui fut récompensé par le Prix Nobel: ELIAS CANETTI et si je ne devais citer qu'une oeuvre de Canetti, ce serait son oeuvre autobiographique La langue sauvée
Elias Canetti, dans ce livre, évoque sa jeunesse et plus particulièrement ses souvenirs d’enfance entre 1905 et 1921. Il nous livre ici le récit de son éducation qu’il recoit en Europe Centrale au début du siècle, dans une époque encore insouciante et joyeuse, avant que l’Occident ne soit emporté dans les déflagrations de la Grande Guerre en 1914. Avec beaucoup de sensibilité, il évoque fidèlement ses premiers souvenirs, ses joies et ses peines alors qu’il coulait encore des jours heureux au bord du Danube.
Une bonne illustration de la "langue sauvée" - l'allemand, que sa mère lui avait appris ( et comment! avec tyrannie! Comment ne pas avoir été dégoûté de l'allemand après?!), par amour de la Vienne impériale, et qui représentait à leurs yeux le haut lieu de la culture européenne.
Je te cite un passage de cette oeuvre qui m'a fort marquée :
"L’apprentissage de l’allemand au bord du lac de Genève ( Genève, un clien d'oeil pour toi Kashima, Ton Never(s)...Hiroshima sans amour:-)
J’avais huit ans, je devais aller à l’école à Vienne et notamment entrer dans la 3ème classe de la Volksschule, qui correspondait à mon âge. C’était une pensée insupportable pour ma mère qu’on puisse me refuser l’entrée dans cette classe pour le motif que je ne connaisse pas la langue, et aussi, était-elle décidée à me faire apprendre l’allemand dans les plus brefs délais.
C’est ainsi que peu de temps après notre arrivée, nous nous rendîmes dans une librairie. Ma mère demanda une grammaire anglo-allemande, prit le premier livre qu'on lui donna, me ramena immédiatement à la maison et commença sa leçon.
[…]
Nous nous assîmes dans la salle à manger à la grande table. Je me tenais du côté le plus étroit, de sorte que je pouvais voir le lac, et les bateaux à voiles. Elle se tenait dans le coin, à ma gauche et tenait le livre de telle façon que je ne pouvais rien voir à l’intérieur. Elle le tenait toujours loin de moi. « Tu n’en n’as pas besoin », disait-elle, « de toutes façons, tu ne peux encore rien comprendre ». Mais malgré ces arguments, j’éprouvais le sentiment qu’elle me privait du livre comme d’un secret. Elle me lisait une phrase en allemand et me la faisait répéter. Comme ma prononciation la choquait, je devais la répéter plusieurs fois, jusqu’à ce que la phrase lui fut acceptable. Mais cela n’était pas souvent le cas, et comme pour rien au monde, je ne voulais supporter sa dérision, je me donnais de la peine et parlais bientôt correctement. Alors seulement, elle me disait ce que la phrase signifiait en anglais. Cependant, elle ne la répétait jamais et je devais la retenir une fois pour toutes. Elle passait alors à une autre phrase et c’était la même démarche : dès que j’avais prononcé correctement, elle traduisait la phrase, me regardait d’un air dictatorial, dont je me souviens très bien, et passait à la suivante.
Je ne sais pas combien de phrases, elle m’avait demandé la première fois. Disons, pour être modéré, quelques unes. Mais je crains qu’elle étaient nombreuses, en fait.
Elle me congédiait et me disait : « répète cela pour toi. Tu ne dois oublier aucune phrase. Pas même une seule. Demain nous continuerons ». Elle gardait le livre et je me retrouvais seul dans mon embarras.
Je n’avais aucune aide, Miss Bray ne parlait qu’anglais, et pendant la journée, ma mère refusait de me prononcer les phrases. Le jour suivant, j’étais assis à la même place, la fenêtre ouverte devant moi, avec le lac et les bateaux à voiles."
Invité- Invité
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Tout cela mérite plus ample commentaire que ces quelques mots qui vont suivre...
Juste pour ce soir : "Genève, un clin d'oeil pour toi Kashima, Ton Never(s)...Hiroshima sans amour:-) ", joliment dit, Genève et les ténèbres dissipées, un Hiroshima, oui!
Je découvre beaucoup des auteurs dont tu parles, c'est vraiment intéressant car tu n'as pas la même approche que moi de la littérature.
Juste pour ce soir : "Genève, un clin d'oeil pour toi Kashima, Ton Never(s)...Hiroshima sans amour:-) ", joliment dit, Genève et les ténèbres dissipées, un Hiroshima, oui!
Je découvre beaucoup des auteurs dont tu parles, c'est vraiment intéressant car tu n'as pas la même approche que moi de la littérature.
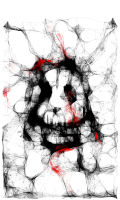
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Enigma a écrit:Oh Verbatim, moi qui m'attendais à une nouvelle critique/ attaque de ta part...m'en voilà fort flattée:-)
Je suis taquin, mais j'ai bon fond (enfin je crois, sauf quand on critique Yourcenar...).
Autrement, ma vie ne tourne pas autour de la littérature, pas du tout ; nous évoluons dans deux mondes différents, je vais donc boire tes paroles avec l'esprit le plus ouvert possible! ;-)
Invité- Invité
 écriture de l'exil. Autre approche de la littérature?
écriture de l'exil. Autre approche de la littérature?
Kashima, c'est clair que notre approche littéraire "dévie"! Tu es une littéraire et je suis philosophe.
Qui plus est, même si tu maîtrises le latin et le grec, tu "n'habites" pas dans ces langues "mortes" et avant tout, tu ne connais pas, contrairement à moi, le sentiment d'être apatride et de vivre, d'écrire et même de parler dans l'exil! Notre approche sera toujours en différAnt ( la différAnce Déridienne:-)
Qui plus est, même si tu maîtrises le latin et le grec, tu "n'habites" pas dans ces langues "mortes" et avant tout, tu ne connais pas, contrairement à moi, le sentiment d'être apatride et de vivre, d'écrire et même de parler dans l'exil! Notre approche sera toujours en différAnt ( la différAnce Déridienne:-)
Invité- Invité
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
C'est vrai.
Je ne les ressens pas comme on doit sentir une langue qu'on parle. Ces langues sont là, derrière la français, le complètent. Parler une autre langue vivante dans l'exil ou pouvoir comprendre chez soi une langue qui ne vit plus sont des expériences totalement différAntes...
Je ne les ressens pas comme on doit sentir une langue qu'on parle. Ces langues sont là, derrière la français, le complètent. Parler une autre langue vivante dans l'exil ou pouvoir comprendre chez soi une langue qui ne vit plus sont des expériences totalement différAntes...
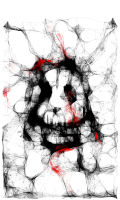
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Trans-lecture/ écriture: écrire dans une langue étrangère. Makine-Tawada
Trans-lecture/ écriture: écrire dans une langue étrangère. Makine-Tawada
Enigma, je déplace ce que tu as écrit sur Makine et Tawada ici, dans l'écriture de l'exil.
Trans-lecture/ écriture: écrire dans une langue étrangère. Makine-Tawada
Message posté le: Ven 13 Aoû - 19:16 par Enigma
Kashima, en suggérant Le testament francais de Makine, tu m'as donné une idée de lecture que je nomme "trans-lecture/ écriture" qui consisterait à présenter des auteurs n'écrivant pas dans leur langue maternelle, des auteurs de l'exil, apatrides.
Makine, né en Russie est un écrivain de langue francaise. Sa terre d'exil est la France, celle de Tawada: l'Allemagne.
Tawada que tu as évoquée également est japonaise et écrit en japonais et en allemand. Qui plus est, elle est russophone et russophile et a recu le Prix Adelbert von Chamisso, décerné par la fondation Robert Bosch, récompensant chaque année des écrivains d'expression allemande pour lesquels l'allemand n'est pas la langue maternelle. Depuis sa création en 1985, ce prix a été attribué à 45 auteurs de 20 pays différents. Le prix est délivré par l'Académie bavaroise des Beaux-Arts.
Je suppose qu'il y a aussi en France, un Prix équivalent. Lequel?

Yoko Tawada
« Issu d’une famille de commerçants ruinée par les bombardements, le père de Yoko Tawada s’installe à Tokyo juste après la guerre avec un baluchon pour seul bagage. De lui, sa famille dit qu’il est "contaminé par le mal rouge" – l’un des premiers mots dont s’étonne sa petite fille, née en 1960. Comment la peau de son père peut-elle être rouge tout en ne l’étant pas ? Elle n’aura pas fini de s’interroger sur la peau et les mots…
Yoko Tawada raconte également dans Narrateurs sans âmes le très beau petit livre qui la révéla en France (Verdier, 2001) – comment la triple invocation "À Moscou, à Moscou, à Moscou !" était devenue, en famille, l’image de l’inaccessible. Ses parents avaient entendu l’appel lors d’une représentation des Trois sœurs de Tchekhov. Pour les trois femmes, c’est la ville de leurs chimères. Elles ne s’y rendront jamais. Pour les parents de Yoko, frappés par le chômage, Moscou sonnait comme une formule magique. Ils l’évoquaient en riant de leurs propres illusions. "À Moscou !" Le père n’en poursuivait pas moins son projet "irréaliste" de fonder une maison d’édition.
On pouvait le prévoir. Yoko Tawada commence par étudier le russe, envisageant de se spécialiser en slavistique. À 19 ans, elle part vers la ville mythique où se résume, pour elle, l’objet fabuleux nommé "Europe". Ce voyage, la Japonaise le fera en train, son mode de transport favori. Elle s’en explique dans Narrateurs sans âmes et dans les treize courts récits – treize "voitures", dit-elle – de Train de nuit avec suspects.
"J’ai lu dans un livre sur les Indiens que l’âme ne peut pas voler plus vite qu’un avion. C’est pourquoi on perd son âme quand on voyage en avion, et on arrive à destination mentalement absent. Même le Transsibérien roule plus vite qu’une âme peut voler. Lors de ma première venue en Europe, par le Transsibérien, j’ai perdu mon âme. Quand je suis repartie par le train, mon âme était encore en route vers l’Europe. Je n’ai pas pu l’attraper. Lorsque je suis revenue en Europe, elle était en route vers le Japon […]. Je ne sais plus du tout où mon âme se trouve."
Toute russophone qu’elle soit, et fascinée par la France, comme en témoigne le roman L’Œil nu – autre nouveauté de cette rentrée –, Yoko Tawada choisit néanmoins l’Allemagne. C’est le pays de Peter Schlemil, l’homme qui perdit son ombre.
Pendant que le corps écrit du côté de Hambourg – là où Yoko Tawada s’est installée –, l’âme poursuit ses voyages à la fois chamaniques, fantaisistes et pleins d’ironique sagesse. Yoko examine avec perplexité les situations où se trouve Tawada. « Le doute, par ribambelles, enfante des ogres », lit-on dans Train de nuit. Faut-il s’étonner que la jeune femme, devenue germanophone, ait consacré sa thèse (en allemand) au thème de l’automate et des poupées parlantes, particulièrement cher à Hoffmann : "Jouet et magie verbale dans la littérature européenne."
Nous n’en sommes pas là, toutefois, quand Yoko Tawada s’installe à Hambourg, en 1982. Venue faire un stage en librairie, elle travaille d’abord dans une société d’exportation et de distribution de livres – réalisant ainsi le rêve paternel. Après avoir parachevé ses études de littérature allemande, elle se consacre à ses propres livres. Elle écrit alternativement en japonais et dans sa nouvelle langue : poésie, théâtre, textes courts, romans.
D’abord publiée en Allemagne, Yoko Tawada trouve un éditeur au Japon. Dès lors, elle poursuit son œuvre double mais évite de traduire elle-même ses textes japonais en allemand, alors qu’il lui arrive de se traduire de l’allemand en japonais, voire de mêler dans un même livre des textes en japonais, leur traduction allemande et des textes rédigés en allemand.
Son traducteur français, Bernard Banoun, résume en une belle formule ce rapport aux idéogrammes et à l’alphabet latin, qui est un rapport aux signes : "Allemand et japonais : ce sont deux systèmes de pensée, deux œuvres différentes à thèmes communs. Yoko le dit souvent : lorsqu’elle parle l’anglais, elle se traduit de l’allemand, alors qu’elle ne se traduit pas du japonais lorsqu’elle parle l’allemand." Et c’est avec une certaine malice que la Japonaise évoque Catherine Deneuve dans L’Œil nu – Catherine Deneuve, figure onirique pour une jeune Vietnamienne venue de RDA, seule à Paris en 1988, ignorant tout du français et plongée dans les films où joue l’actrice. Jeu de lettres aussi : le caractère C, disséminé dans le texte, pose plus d’un problème à la langue allemande dont on connaît la prédilection pour le K.
Juvénile, attentive, mobile, Yoko Tawada est d’une incroyable souplesse. Elle se veut d’une "disponibilité totale, mentale et sensorielle", une caisse de résonance pour des voix polyphoniques. Elle aime s’associer d’autres formes d’expression, alliant texte, piano et danse. »
Jean-Maurice de Montremy, Livres Hebdo, juin 2005
Message posté le: Ven 13 Aoû - 23:04 par Kashima
Très bonne idée de sujet.
Les auteurs arabes m'épatent souvent par leur maîtrise de la langue française.
Pour moi, c'est un mystère : comment sentir profondément une langue autre que la sienne? Je ne saurais pas écrire autrement qu'en français, j'aurais l'impression que les mots m'échappent.
Nabokov et Beckett, me semblent-ils, étaient dans ce cas de figure.
Hannah Arendt n'est pas loin, grâce à ton sujet, ses mots sur la langue mère non plus.
Trans-lecture/ écriture
Message posté le: Sam 14 Aoû - 0:37 par Enigma
Nabokov, Beckett oui mais encore une fois n'oublie pas la beauté en triade du corps platonicien!...Et qu'en est-il de Cioran?
Tu ne peux pas t'imaginer écrire dans une langue, autre que ta langue maternelle car tu ne connais pas ce sentiment d'être "apatride" et tu penses et "habites" ( je reprends la formule heideggérienne que je développerai plus tard en référence à Hölderlin) dans une langue, qui est ta langue maternelle. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Ma langue "maternelle" m'est depuis longtemps "étrangère.
Tu évoques Arendt, à juste titre...N'oublie pas Kristeva dans cet exil!
" Je peux promettre de ne jamais cesser d’être une Allemande au sens où vous l’entendez ; c’est-à-dire que je ne renierai rien, ni votre Allemagne et celle de Heinrich, ni la tradition dans laquelle j’ai grandi, la langue dans laquelle je pense et dans laquelle ont été écrits les poèmes que je préfère. Je ne me raconterai pas d’histoires, je ne m’inventerai ni un passé juif ni un passé américain." Hannah Arendt
Quant aux auteurs arabes, quel mérite?! Quand tu dis "arabe", j'entends "Maghreb"...anciennes colonies francaises où l'on parle encore francais!
Message posté le: Sam 14 Aoû - 0:55 par Enigma
Dans une lettre antérieure à Karl Jaspers du 1er janvier 1933, Hannah Arendt précisait ce qu’était pour elle l’Allemagne : « La langue maternelle, la philosophie et la poésie. » Dans cette lettre à Karl Jaspers, du 19 février 1953, Hannah Arendt évoque par son prénom Heinrich Heine , poète allemand d’origine juive qui s’est converti au protestantisme en 1825. Sa conversion fut pour lui, note-t-il avec quelque ironie, « un billet d’entrée donnant accès à la civilisation européenne ». Il fait partie des juifs d’exception du XIXe siècle qu’Hannah Arendt évoque dans La tradition cachée, qui « auraient pu être allemands par la grâce de Goethe »
Plus tard, à propos de Walter Benjamin, elle revient sur l’importance de la langue : « Dans la langue, ce qui est passé a son assise indéracinable et c’est sur la langue que viennent finalement échouer toutes les tentatives pour se débarrasser du passé. » Ce qui amène Martine Leibovici à écrire « Arendt a véritablement emporté la langue allemande avec elle, de sorte que c’est l’exil lui-même qui est à la source […] de ce sauvetage.
Arendt
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:10 par Enigma
Aucune situation ne dispose davantage à poser la question de la langue maternelle que celle de l’exil. C'est la dépossession d’une langue première dont on est privé par les aléas de la vie et dont on a la mémoire ou la nostalgie, qui donne toute sa force dramatique à cette question. Hannah Arendt s’est exilée en France de 1933 à 1940 avant d’aller aux Etats-Unis. Au moment où elle quitte l’Allemagne, que représente pour elle ce pays natal où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans — «La langue maternelle, la philosophie et la poésie», écrit-elle à Karl Jaspers en 1933 . Pendant tout le reste de sa vie qu’elle passe en exil, elle ne cessera de manifester son attachement à la langue de sa jeunesse. Même aux temps les plus amers, au temps de la shoah, lui demande-t-on au cours d’une émouvante interview dans les années soixante — «Toujours. Je me disais: que faire? Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle!»
Notre langue maternelle est la langue de notre mémoire. Une première attitude découle de cette constatation, celle de la fidélité à cette langue en dépit de toutes les aliénations....
Je vis dans "la mémoire" de cette langue maternelle..."langue étrangère et philosophie"...ma réponse en Echo à Arendt...
Arendt
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:20 par Enigma
Aux sources de notre fidélité il y a les textes de la langue première que nous avons appris par cœur. Ce dont témoigne Hannah Arendt: «J’ai toujours refusé, consciemment, de perdre ma langue maternelle, déclare-t-elle en 1963 (elle a 57 ans et vit aux Etats-Unis). J’ai toujours maintenu une certaine distance tant vis-à-vis du français que j’écrivais très bien autrefois, que vis-à-vis de l’anglais que j’écris maintenant.» Et elle en donne l’explication suivante:
J’écris en anglais, mais je garde toujours une certaine distance. ( exactement, la distance que je garde en allemand!) Il y a une différence incroyable entre la langue maternelle et toute autre langue. Pour moi, cet écart se résume de façon très simple: je connais par cœur en allemand un bon nombre de poèmes allemands; ils sont présents d’une certaine manière au plus profond de ma mémoire, derrière ma tête, in the back of my mind, et il est bien sûr impossible de pouvoir jamais reproduire cela! En allemand, je me permets des choses que je ne me serais jamais permises en anglais.
C’est dans l’impossibilité de pratiquer sa langue maternelle que l’on prend conscience de la présence sensorielle de la langue au fond de la vie mentale et du lien qui existe entre parler et penser. S’exprimer dans sa langue maternelle, c’est avoir la certitude de ne pas trahir sa pensée. «Dans une autre langue les mots me manquent», dit-on parfois, ou: «Je le dis mieux dans cette langue-ci plutôt que dans celle-là»...pourtant, j'ai "l'impression" de mieux m'exprimer en allemand...
Arendt-Kristeva: la langue maternelle
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:29 par Enigma
Un témoignage émouvant de Julia Kristeva confirme l’existence et la violence de cette dialectique entre l’aisance et la distance dans notre rapport intime aux langues que nous parlons. «Je n’ai pas perdu ma langue maternelle.» Ce sont les premiers mots d’une confession intitulée Bulgarie, ma souffrance qui la conduit pourtant à s’écrier : «Corps et âme, je vis en français.»Malgré des bouffées de mémoire dans lesquelles le roumain subvertit de l’intérieur le français, Julia Kristeva a littéralement changé de langue maternelle. Une partie de moi s’est éteinte, dit-elle, «au fur et à mesure que j’apprenais le français chez les Dominicaines, puis à l’Alliance, puis à l’université; et qu’enfin l’exil a cadavérisé ce vieux corps, pour lui en substituer un autre… le français.» Mais ce n’est pas tout à fait vrai, ce n’est pas définitif. Le drame qui se joue entre les deux langues tourne très précisément autour de l’aisance et de la distance de la personne qui parle par rapport à la langue qu’elle parle dans une situation donnée. Lorsqu’elle doit s’exprimer en russe ou en anglais et que les mots lui manquent, c’est au bulgare que Julia Kristeva se cramponne: «Ce n’est donc pas le français qui me vient à l’aide quand je suis en panne dans un code artificiel, pas plus que si, fatiguée, je sèche sur mes additions et multiplications, mais bien le bulgare, pour me signifier que je n’ai pas perdu les commencements.» Ainsi donc la même personne vit corps et âme dans deux langues étrangères l’une à l’autre, à différents moments du temps et dans des situations différentes.
Ce que je retiens de ce témoignage, c’est le jeu des deux critères permettant de caractériser la langue maternelle: la langue dans laquelle je vibre de toutes les fibres de ma sensibilité, et la langue à laquelle je me cramponne et qui me sauve lorsque les mots me manquent...
Je ressens le même sentiment que Kristeva...avoir littéralement changé de langue maternelle....et les conséquences!
Cioran - Maghreb
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:31 par Kashima
Enigma a écrit:Nabokov, Beckett oui mais encore une fois n'oublie pas la beauté en triade du corps platonicien!...Et qu'en est-il de Cioran?
" Je peux promettre de ne jamais cesser d’être une Allemande au sens où vous l’entendez ; c’est-à-dire que je ne renierai rien, ni votre Allemagne et celle de Heinrich, ni la tradition dans laquelle j’ai grandi, la langue dans laquelle je pense et dans laquelle ont été écrits les poèmes que je préfère. Je ne me raconterai pas d’histoires, je ne m’inventerai ni un passé juif ni un passé américain." Hannah Arendt
Quant aux auteurs arabes, quel mérite?! Quand tu dis "arabe", j'entends "Maghreb"...anciennes colonies francaises où l'on parle encore francais!
Comment oublier Cioran? Impossible. Un philosophe-poète, cet homme. Quelle beauté de la langue non maternelle, c'en est stupéfiant. J'ouvrirai un topic sur lui ou chercherai certains de ses aphorismes à retranscrire ici.
Je ne peux pas comprendre ce que c'est que d'habiter ailleurs que dans sa langue, je n'en ai pas fait l'expérience, n'en ferai jamais l'expérience non plus.
Je parlais en effet des auteurs du Maghreb... Parler français, peut-être, mais savoir le manier, l'écrire, sachant que la langue certainement parlée au quotidien est l'arabe me semble se rapprocher de cette trans-écriture. De plus, écrire dans la langue de l'ancien colon pose le problème de l'acceptation, de l'assimilation morale de cette langue... Peut-être un autre sujet.
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:48 par Kashima
Enigma a écrit: Même aux temps les plus amers, au temps de la shoah, lui demande-t-on au cours d’une émouvante interview dans les années soixante — «Toujours. Je me disais: que faire? Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle!»
Notre langue maternelle est la langue de notre mémoire. Une première attitude découle de cette constatation, celle de la fidélité à cette langue en dépit de toutes les aliénations....
Cette langue est comme un gène, on ne peut pas se rebeller, même avec tous les efforts du monde.
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:58 par Verbatim
Et puis pourquoi le faire? Dans notre cas, le français donne accès à tellement de "belles choses" ...
Pourquoi?
Message posté le: Sam 14 Aoû - 11:15 par Enigma
Verbatim, je parle d'écrivains écrivant dans une langue étrangère!...Cette langue étrangère peut aussi être l'unique langue qui mérite ce nom, à tes yeux: le FRANCAIS!!!
Et pourquoi vouloir ouvrir son horizon?! Nous n'avons, comme je vois aucun atome crochu!
"Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue." Goethe
Message posté le: Sam 14 Aoû - 11:30 par Verbatim
J'avais compris...
Je disais juste qu'il y a beaucoup de très grands écrivains qui sont français, et que nous avons de la chance de pouvoir y avoir accès via notre langue maternelle, car la résonance est forcément plus immédiate et intense...
Je crois que l'on ne peut vraiment bien écrire que dans une seule langue, peu importante qu'elle soit maternelle ou pas, c'est une question de maîtrise.
Et c'est justement pour cela que je lis les auteurs anglais dans leur langue, pour ne rien perdre.
Car le traducteur, dans le cas d'un livre écrit dans une langue "étrangère", est au moins aussi important que l'écrivain : et il vaut mieux qu'il soit bon...
Lost in translation?
Quant à nos atomes crochus, je te laisse juge...
Trans-lecture/ écriture: écrire dans une langue étrangère. Makine-Tawada
Message posté le: Ven 13 Aoû - 19:16 par Enigma
Kashima, en suggérant Le testament francais de Makine, tu m'as donné une idée de lecture que je nomme "trans-lecture/ écriture" qui consisterait à présenter des auteurs n'écrivant pas dans leur langue maternelle, des auteurs de l'exil, apatrides.
Makine, né en Russie est un écrivain de langue francaise. Sa terre d'exil est la France, celle de Tawada: l'Allemagne.
Tawada que tu as évoquée également est japonaise et écrit en japonais et en allemand. Qui plus est, elle est russophone et russophile et a recu le Prix Adelbert von Chamisso, décerné par la fondation Robert Bosch, récompensant chaque année des écrivains d'expression allemande pour lesquels l'allemand n'est pas la langue maternelle. Depuis sa création en 1985, ce prix a été attribué à 45 auteurs de 20 pays différents. Le prix est délivré par l'Académie bavaroise des Beaux-Arts.
Je suppose qu'il y a aussi en France, un Prix équivalent. Lequel?

Yoko Tawada
« Issu d’une famille de commerçants ruinée par les bombardements, le père de Yoko Tawada s’installe à Tokyo juste après la guerre avec un baluchon pour seul bagage. De lui, sa famille dit qu’il est "contaminé par le mal rouge" – l’un des premiers mots dont s’étonne sa petite fille, née en 1960. Comment la peau de son père peut-elle être rouge tout en ne l’étant pas ? Elle n’aura pas fini de s’interroger sur la peau et les mots…
Yoko Tawada raconte également dans Narrateurs sans âmes le très beau petit livre qui la révéla en France (Verdier, 2001) – comment la triple invocation "À Moscou, à Moscou, à Moscou !" était devenue, en famille, l’image de l’inaccessible. Ses parents avaient entendu l’appel lors d’une représentation des Trois sœurs de Tchekhov. Pour les trois femmes, c’est la ville de leurs chimères. Elles ne s’y rendront jamais. Pour les parents de Yoko, frappés par le chômage, Moscou sonnait comme une formule magique. Ils l’évoquaient en riant de leurs propres illusions. "À Moscou !" Le père n’en poursuivait pas moins son projet "irréaliste" de fonder une maison d’édition.
On pouvait le prévoir. Yoko Tawada commence par étudier le russe, envisageant de se spécialiser en slavistique. À 19 ans, elle part vers la ville mythique où se résume, pour elle, l’objet fabuleux nommé "Europe". Ce voyage, la Japonaise le fera en train, son mode de transport favori. Elle s’en explique dans Narrateurs sans âmes et dans les treize courts récits – treize "voitures", dit-elle – de Train de nuit avec suspects.
"J’ai lu dans un livre sur les Indiens que l’âme ne peut pas voler plus vite qu’un avion. C’est pourquoi on perd son âme quand on voyage en avion, et on arrive à destination mentalement absent. Même le Transsibérien roule plus vite qu’une âme peut voler. Lors de ma première venue en Europe, par le Transsibérien, j’ai perdu mon âme. Quand je suis repartie par le train, mon âme était encore en route vers l’Europe. Je n’ai pas pu l’attraper. Lorsque je suis revenue en Europe, elle était en route vers le Japon […]. Je ne sais plus du tout où mon âme se trouve."
Toute russophone qu’elle soit, et fascinée par la France, comme en témoigne le roman L’Œil nu – autre nouveauté de cette rentrée –, Yoko Tawada choisit néanmoins l’Allemagne. C’est le pays de Peter Schlemil, l’homme qui perdit son ombre.
Pendant que le corps écrit du côté de Hambourg – là où Yoko Tawada s’est installée –, l’âme poursuit ses voyages à la fois chamaniques, fantaisistes et pleins d’ironique sagesse. Yoko examine avec perplexité les situations où se trouve Tawada. « Le doute, par ribambelles, enfante des ogres », lit-on dans Train de nuit. Faut-il s’étonner que la jeune femme, devenue germanophone, ait consacré sa thèse (en allemand) au thème de l’automate et des poupées parlantes, particulièrement cher à Hoffmann : "Jouet et magie verbale dans la littérature européenne."
Nous n’en sommes pas là, toutefois, quand Yoko Tawada s’installe à Hambourg, en 1982. Venue faire un stage en librairie, elle travaille d’abord dans une société d’exportation et de distribution de livres – réalisant ainsi le rêve paternel. Après avoir parachevé ses études de littérature allemande, elle se consacre à ses propres livres. Elle écrit alternativement en japonais et dans sa nouvelle langue : poésie, théâtre, textes courts, romans.
D’abord publiée en Allemagne, Yoko Tawada trouve un éditeur au Japon. Dès lors, elle poursuit son œuvre double mais évite de traduire elle-même ses textes japonais en allemand, alors qu’il lui arrive de se traduire de l’allemand en japonais, voire de mêler dans un même livre des textes en japonais, leur traduction allemande et des textes rédigés en allemand.
Son traducteur français, Bernard Banoun, résume en une belle formule ce rapport aux idéogrammes et à l’alphabet latin, qui est un rapport aux signes : "Allemand et japonais : ce sont deux systèmes de pensée, deux œuvres différentes à thèmes communs. Yoko le dit souvent : lorsqu’elle parle l’anglais, elle se traduit de l’allemand, alors qu’elle ne se traduit pas du japonais lorsqu’elle parle l’allemand." Et c’est avec une certaine malice que la Japonaise évoque Catherine Deneuve dans L’Œil nu – Catherine Deneuve, figure onirique pour une jeune Vietnamienne venue de RDA, seule à Paris en 1988, ignorant tout du français et plongée dans les films où joue l’actrice. Jeu de lettres aussi : le caractère C, disséminé dans le texte, pose plus d’un problème à la langue allemande dont on connaît la prédilection pour le K.
Juvénile, attentive, mobile, Yoko Tawada est d’une incroyable souplesse. Elle se veut d’une "disponibilité totale, mentale et sensorielle", une caisse de résonance pour des voix polyphoniques. Elle aime s’associer d’autres formes d’expression, alliant texte, piano et danse. »
Jean-Maurice de Montremy, Livres Hebdo, juin 2005
Message posté le: Ven 13 Aoû - 23:04 par Kashima
Très bonne idée de sujet.
Les auteurs arabes m'épatent souvent par leur maîtrise de la langue française.
Pour moi, c'est un mystère : comment sentir profondément une langue autre que la sienne? Je ne saurais pas écrire autrement qu'en français, j'aurais l'impression que les mots m'échappent.
Nabokov et Beckett, me semblent-ils, étaient dans ce cas de figure.
Hannah Arendt n'est pas loin, grâce à ton sujet, ses mots sur la langue mère non plus.
Trans-lecture/ écriture
Message posté le: Sam 14 Aoû - 0:37 par Enigma
Nabokov, Beckett oui mais encore une fois n'oublie pas la beauté en triade du corps platonicien!...Et qu'en est-il de Cioran?
Tu ne peux pas t'imaginer écrire dans une langue, autre que ta langue maternelle car tu ne connais pas ce sentiment d'être "apatride" et tu penses et "habites" ( je reprends la formule heideggérienne que je développerai plus tard en référence à Hölderlin) dans une langue, qui est ta langue maternelle. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Ma langue "maternelle" m'est depuis longtemps "étrangère.
Tu évoques Arendt, à juste titre...N'oublie pas Kristeva dans cet exil!
" Je peux promettre de ne jamais cesser d’être une Allemande au sens où vous l’entendez ; c’est-à-dire que je ne renierai rien, ni votre Allemagne et celle de Heinrich, ni la tradition dans laquelle j’ai grandi, la langue dans laquelle je pense et dans laquelle ont été écrits les poèmes que je préfère. Je ne me raconterai pas d’histoires, je ne m’inventerai ni un passé juif ni un passé américain." Hannah Arendt
Quant aux auteurs arabes, quel mérite?! Quand tu dis "arabe", j'entends "Maghreb"...anciennes colonies francaises où l'on parle encore francais!
Message posté le: Sam 14 Aoû - 0:55 par Enigma
Dans une lettre antérieure à Karl Jaspers du 1er janvier 1933, Hannah Arendt précisait ce qu’était pour elle l’Allemagne : « La langue maternelle, la philosophie et la poésie. » Dans cette lettre à Karl Jaspers, du 19 février 1953, Hannah Arendt évoque par son prénom Heinrich Heine , poète allemand d’origine juive qui s’est converti au protestantisme en 1825. Sa conversion fut pour lui, note-t-il avec quelque ironie, « un billet d’entrée donnant accès à la civilisation européenne ». Il fait partie des juifs d’exception du XIXe siècle qu’Hannah Arendt évoque dans La tradition cachée, qui « auraient pu être allemands par la grâce de Goethe »
Plus tard, à propos de Walter Benjamin, elle revient sur l’importance de la langue : « Dans la langue, ce qui est passé a son assise indéracinable et c’est sur la langue que viennent finalement échouer toutes les tentatives pour se débarrasser du passé. » Ce qui amène Martine Leibovici à écrire « Arendt a véritablement emporté la langue allemande avec elle, de sorte que c’est l’exil lui-même qui est à la source […] de ce sauvetage.
Arendt
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:10 par Enigma
Aucune situation ne dispose davantage à poser la question de la langue maternelle que celle de l’exil. C'est la dépossession d’une langue première dont on est privé par les aléas de la vie et dont on a la mémoire ou la nostalgie, qui donne toute sa force dramatique à cette question. Hannah Arendt s’est exilée en France de 1933 à 1940 avant d’aller aux Etats-Unis. Au moment où elle quitte l’Allemagne, que représente pour elle ce pays natal où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans — «La langue maternelle, la philosophie et la poésie», écrit-elle à Karl Jaspers en 1933 . Pendant tout le reste de sa vie qu’elle passe en exil, elle ne cessera de manifester son attachement à la langue de sa jeunesse. Même aux temps les plus amers, au temps de la shoah, lui demande-t-on au cours d’une émouvante interview dans les années soixante — «Toujours. Je me disais: que faire? Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle!»
Notre langue maternelle est la langue de notre mémoire. Une première attitude découle de cette constatation, celle de la fidélité à cette langue en dépit de toutes les aliénations....
Je vis dans "la mémoire" de cette langue maternelle..."langue étrangère et philosophie"...ma réponse en Echo à Arendt...
Arendt
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:20 par Enigma
Aux sources de notre fidélité il y a les textes de la langue première que nous avons appris par cœur. Ce dont témoigne Hannah Arendt: «J’ai toujours refusé, consciemment, de perdre ma langue maternelle, déclare-t-elle en 1963 (elle a 57 ans et vit aux Etats-Unis). J’ai toujours maintenu une certaine distance tant vis-à-vis du français que j’écrivais très bien autrefois, que vis-à-vis de l’anglais que j’écris maintenant.» Et elle en donne l’explication suivante:
J’écris en anglais, mais je garde toujours une certaine distance. ( exactement, la distance que je garde en allemand!) Il y a une différence incroyable entre la langue maternelle et toute autre langue. Pour moi, cet écart se résume de façon très simple: je connais par cœur en allemand un bon nombre de poèmes allemands; ils sont présents d’une certaine manière au plus profond de ma mémoire, derrière ma tête, in the back of my mind, et il est bien sûr impossible de pouvoir jamais reproduire cela! En allemand, je me permets des choses que je ne me serais jamais permises en anglais.
C’est dans l’impossibilité de pratiquer sa langue maternelle que l’on prend conscience de la présence sensorielle de la langue au fond de la vie mentale et du lien qui existe entre parler et penser. S’exprimer dans sa langue maternelle, c’est avoir la certitude de ne pas trahir sa pensée. «Dans une autre langue les mots me manquent», dit-on parfois, ou: «Je le dis mieux dans cette langue-ci plutôt que dans celle-là»...pourtant, j'ai "l'impression" de mieux m'exprimer en allemand...
Arendt-Kristeva: la langue maternelle
Message posté le: Sam 14 Aoû - 1:29 par Enigma
Un témoignage émouvant de Julia Kristeva confirme l’existence et la violence de cette dialectique entre l’aisance et la distance dans notre rapport intime aux langues que nous parlons. «Je n’ai pas perdu ma langue maternelle.» Ce sont les premiers mots d’une confession intitulée Bulgarie, ma souffrance qui la conduit pourtant à s’écrier : «Corps et âme, je vis en français.»Malgré des bouffées de mémoire dans lesquelles le roumain subvertit de l’intérieur le français, Julia Kristeva a littéralement changé de langue maternelle. Une partie de moi s’est éteinte, dit-elle, «au fur et à mesure que j’apprenais le français chez les Dominicaines, puis à l’Alliance, puis à l’université; et qu’enfin l’exil a cadavérisé ce vieux corps, pour lui en substituer un autre… le français.» Mais ce n’est pas tout à fait vrai, ce n’est pas définitif. Le drame qui se joue entre les deux langues tourne très précisément autour de l’aisance et de la distance de la personne qui parle par rapport à la langue qu’elle parle dans une situation donnée. Lorsqu’elle doit s’exprimer en russe ou en anglais et que les mots lui manquent, c’est au bulgare que Julia Kristeva se cramponne: «Ce n’est donc pas le français qui me vient à l’aide quand je suis en panne dans un code artificiel, pas plus que si, fatiguée, je sèche sur mes additions et multiplications, mais bien le bulgare, pour me signifier que je n’ai pas perdu les commencements.» Ainsi donc la même personne vit corps et âme dans deux langues étrangères l’une à l’autre, à différents moments du temps et dans des situations différentes.
Ce que je retiens de ce témoignage, c’est le jeu des deux critères permettant de caractériser la langue maternelle: la langue dans laquelle je vibre de toutes les fibres de ma sensibilité, et la langue à laquelle je me cramponne et qui me sauve lorsque les mots me manquent...
Je ressens le même sentiment que Kristeva...avoir littéralement changé de langue maternelle....et les conséquences!
Cioran - Maghreb
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:31 par Kashima
Enigma a écrit:Nabokov, Beckett oui mais encore une fois n'oublie pas la beauté en triade du corps platonicien!...Et qu'en est-il de Cioran?
" Je peux promettre de ne jamais cesser d’être une Allemande au sens où vous l’entendez ; c’est-à-dire que je ne renierai rien, ni votre Allemagne et celle de Heinrich, ni la tradition dans laquelle j’ai grandi, la langue dans laquelle je pense et dans laquelle ont été écrits les poèmes que je préfère. Je ne me raconterai pas d’histoires, je ne m’inventerai ni un passé juif ni un passé américain." Hannah Arendt
Quant aux auteurs arabes, quel mérite?! Quand tu dis "arabe", j'entends "Maghreb"...anciennes colonies francaises où l'on parle encore francais!
Comment oublier Cioran? Impossible. Un philosophe-poète, cet homme. Quelle beauté de la langue non maternelle, c'en est stupéfiant. J'ouvrirai un topic sur lui ou chercherai certains de ses aphorismes à retranscrire ici.
Je ne peux pas comprendre ce que c'est que d'habiter ailleurs que dans sa langue, je n'en ai pas fait l'expérience, n'en ferai jamais l'expérience non plus.
Je parlais en effet des auteurs du Maghreb... Parler français, peut-être, mais savoir le manier, l'écrire, sachant que la langue certainement parlée au quotidien est l'arabe me semble se rapprocher de cette trans-écriture. De plus, écrire dans la langue de l'ancien colon pose le problème de l'acceptation, de l'assimilation morale de cette langue... Peut-être un autre sujet.
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:48 par Kashima
Enigma a écrit: Même aux temps les plus amers, au temps de la shoah, lui demande-t-on au cours d’une émouvante interview dans les années soixante — «Toujours. Je me disais: que faire? Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle!»
Notre langue maternelle est la langue de notre mémoire. Une première attitude découle de cette constatation, celle de la fidélité à cette langue en dépit de toutes les aliénations....
Cette langue est comme un gène, on ne peut pas se rebeller, même avec tous les efforts du monde.
Message posté le: Sam 14 Aoû - 10:58 par Verbatim
Et puis pourquoi le faire? Dans notre cas, le français donne accès à tellement de "belles choses" ...
Pourquoi?
Message posté le: Sam 14 Aoû - 11:15 par Enigma
Verbatim, je parle d'écrivains écrivant dans une langue étrangère!...Cette langue étrangère peut aussi être l'unique langue qui mérite ce nom, à tes yeux: le FRANCAIS!!!
Et pourquoi vouloir ouvrir son horizon?! Nous n'avons, comme je vois aucun atome crochu!
"Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue." Goethe
Message posté le: Sam 14 Aoû - 11:30 par Verbatim
J'avais compris...
Je disais juste qu'il y a beaucoup de très grands écrivains qui sont français, et que nous avons de la chance de pouvoir y avoir accès via notre langue maternelle, car la résonance est forcément plus immédiate et intense...
Je crois que l'on ne peut vraiment bien écrire que dans une seule langue, peu importante qu'elle soit maternelle ou pas, c'est une question de maîtrise.
Et c'est justement pour cela que je lis les auteurs anglais dans leur langue, pour ne rien perdre.
Car le traducteur, dans le cas d'un livre écrit dans une langue "étrangère", est au moins aussi important que l'écrivain : et il vaut mieux qu'il soit bon...
Lost in translation?
Quant à nos atomes crochus, je te laisse juge...
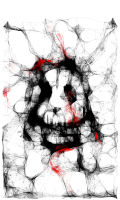
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Ovide, mort en exil
Ovide, mort en exil
Un des écrivains de l'exil forcé est le poète latin Ovide.
Au fait de sa carrière littéraire, Auguste prend la décision de l'envoyer en exil. Les causes exactes de la colère de l'empereur ne sont pas connues :
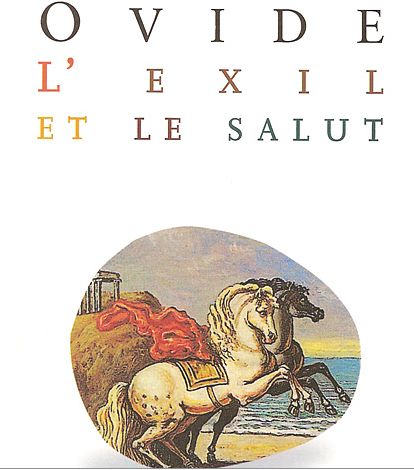
"Diverses hypothèses ont été émises sur les causes de cette relégation. L'une d'elles est que le prétexte aurait été la prétendue immoralité de L'Art d'aimer. Il faut rappeler que le règne d'Auguste est marqué par un fort conservatisme moral, comme en témoigne par exemple la promulgation de la Lex Iulia. On a aussi avancé qu'une relation amoureuse entre la fille d'Auguste — Julie — et le poète aurait déplu à l'empereur."
Ovide part donc dans les pays barbares et non civilisés, lui le Romain habitué à la vie de banquets... Le bout du monde, à l'époque, c'est le Pont-Euxin (Roumanie actuelle).
Le poète ne cessera de supplier l'empereur de lui permettre de rentrer à Rome, mais en vain.
Sa détresse est lisible dans les Tristes et les Pontiques, poèmes de l'exil :
"Va, petit livre, j'y consens, va sans moi dans cette ville où, hélas ! il ne m’est point permis d'aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans ornements, comme il convient au fils de l'exilé ; et malheureux, adopte les insignes du malheur."
"Déjà approchait le jour où je devais, d'après l'ordre de César, franchir les frontières de l'Ausonie : (...) De quelque côté qu'on tournât les yeux, on ne voyait que des gens éplorés et sanglotants ; on eût dit des funérailles, de celles où la douleur n'est pas muette ; hommes, femmes, enfants même pleuraient comme si j'étais mort, et, dans toute la maison, il n'était pas une place qui ne fût arrosée de larmes : tel, si l'on peut comparer de grandes scènes à des scènes moins imposantes, tel dut être l'aspect de Troie au moment de sa chute." (Tristes)
Voilà comment le chanteur des amours humaines et divines a fini sa vie, privé de sa ville natale, dans un pays qu'il exècre...
"Sans doute que, banni de la terre qui m'a vu naître, j'ai trouvé une retraite dans quelque pays habité par des hommes. Mais non, relégué aux extrémités du monde, je languis sur une plage abandonnée, dans une contrée ensevelie sous des neiges éternelles. Ici, dans les campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun arbre fruitier ; le saule n'y verdit point sur le bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes. La mer ne mérite pas plus d'éloges que la terre : toujours privés du soleil et toujours irrités, les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses. De quelque côté que vous portiez les regards, vous ne voyez que des plaines sans culture, et de vastes terrains sans maîtres. À droite et à gauche nous presse un ennemi redoutable, dont le voisinage est une cause de terreurs continuelles." (Pontiques)
Marie Darrieussecq a consacré récemment un livre à ce sujet, récemment (voir https://edencash.forumactif.org/t153-vu-entendulu#3736 )
Au fait de sa carrière littéraire, Auguste prend la décision de l'envoyer en exil. Les causes exactes de la colère de l'empereur ne sont pas connues :
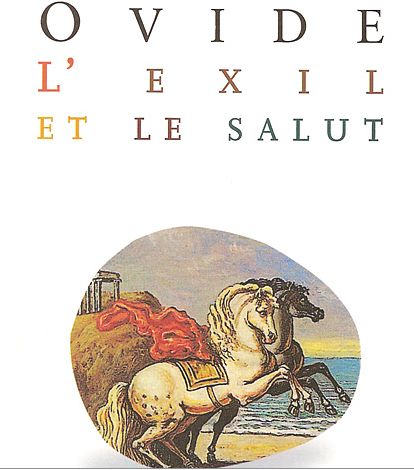
"Diverses hypothèses ont été émises sur les causes de cette relégation. L'une d'elles est que le prétexte aurait été la prétendue immoralité de L'Art d'aimer. Il faut rappeler que le règne d'Auguste est marqué par un fort conservatisme moral, comme en témoigne par exemple la promulgation de la Lex Iulia. On a aussi avancé qu'une relation amoureuse entre la fille d'Auguste — Julie — et le poète aurait déplu à l'empereur."
Ovide part donc dans les pays barbares et non civilisés, lui le Romain habitué à la vie de banquets... Le bout du monde, à l'époque, c'est le Pont-Euxin (Roumanie actuelle).
Le poète ne cessera de supplier l'empereur de lui permettre de rentrer à Rome, mais en vain.
Sa détresse est lisible dans les Tristes et les Pontiques, poèmes de l'exil :
"Va, petit livre, j'y consens, va sans moi dans cette ville où, hélas ! il ne m’est point permis d'aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans ornements, comme il convient au fils de l'exilé ; et malheureux, adopte les insignes du malheur."
"Déjà approchait le jour où je devais, d'après l'ordre de César, franchir les frontières de l'Ausonie : (...) De quelque côté qu'on tournât les yeux, on ne voyait que des gens éplorés et sanglotants ; on eût dit des funérailles, de celles où la douleur n'est pas muette ; hommes, femmes, enfants même pleuraient comme si j'étais mort, et, dans toute la maison, il n'était pas une place qui ne fût arrosée de larmes : tel, si l'on peut comparer de grandes scènes à des scènes moins imposantes, tel dut être l'aspect de Troie au moment de sa chute." (Tristes)
Voilà comment le chanteur des amours humaines et divines a fini sa vie, privé de sa ville natale, dans un pays qu'il exècre...
"Sans doute que, banni de la terre qui m'a vu naître, j'ai trouvé une retraite dans quelque pays habité par des hommes. Mais non, relégué aux extrémités du monde, je languis sur une plage abandonnée, dans une contrée ensevelie sous des neiges éternelles. Ici, dans les campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun arbre fruitier ; le saule n'y verdit point sur le bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes. La mer ne mérite pas plus d'éloges que la terre : toujours privés du soleil et toujours irrités, les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses. De quelque côté que vous portiez les regards, vous ne voyez que des plaines sans culture, et de vastes terrains sans maîtres. À droite et à gauche nous presse un ennemi redoutable, dont le voisinage est une cause de terreurs continuelles." (Pontiques)
Marie Darrieussecq a consacré récemment un livre à ce sujet, récemment (voir https://edencash.forumactif.org/t153-vu-entendulu#3736 )
Dernière édition par Kashima le Mer 6 Juil 2011 - 10:37, édité 1 fois
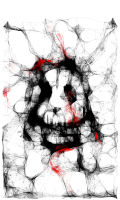
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Julia Kristeva, de la souffrance bulgare au génie féminin
Julia Kristeva, de la souffrance bulgare au génie féminin
Julia Kristeva, de la souffrance bulgare au génie féminin
Par Enigma
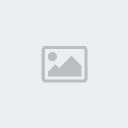
1978, au café Le Bonaparte à Paris: entre autres Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Julia Kristeva, Roland Barthes.
D'abord, il y a l'exil. L'esprit, malgré de savantes investigations, n'en viendra jamais à bout. Julia Kristeva est essayiste, romancière, enseignante et psychanalyste, mais elle est aussi quelqu'un qui, à un moment, a quitté sa terre natale, la Bulgarie.
Transmettre une langue, c’est d’abord s’adresser à des individus. Des individus qui se sont arrachés à leur milieu dans un souci d'aller ailleurs. Cette étrangeté et cette aspiration vers l'autre sont à la fois une épreuve, une douleur et une chance. Si on ne s'adresse pas à cette subjectivité de carrefour, on n'accomplit pas sa tâche technique et linguistique de transmission de la langue.
Il y a du matricide dans l'abandon de la langue maternelle. Partir, c’est couper les liens, dont le plus fondamental : le lien à la langue maternelle. Dans ce deuil infini, où la langue et le corps ressuscitent dans les battements d’un français greffé, s’abrite la mémoire maternelle. Ni involontaire ni inconsciente, je dis bien maternelle : parce qu’à la lisière des mots musiqués et des pulsions innommables, au voisinage du sens et de la biologie que l’imagination a la chance de faire exister, pour moi en français – et la souffrance me revient :
Il y a du matricide et c'est une grande douleur, mais c’est aussi un espoir de renaissance. Apprendre une langue dans le monde moderne consiste aussi à donner une réponse à cet acte d'arrachement, qui est aux portes de l'autonomie. Il faut couper des liens pour devenir un autre. La nouvelle langue devient la promesse de cette nouvelle vie. Bulgarie, ma souffrance, Julia Kristeva
(pour ceux qui auraient envie de lire ce texte si émouvant, dédié à Lydia Uldry-Natcheva, qui pourrait faire Echo à Allemagne, ma souffrance de Thomas Mann, texte auquel Kristeva fait d'ailleurs référence à la fin de Bulgarie, ma souffrance:
http://www.univ-paris-diderot.fr/rbarthes/membres/Bulgarie.pdf
La langue francaise deviendra non pas la seconde patrie de Julia Kristeva, pour reprendre une expression convenue, mais plus encore : sa « vraie vie », comme elle l’écrira dans L’Infini, dans un article intitulé Bulgarie, ma souffrance ( cité précedemment). Au sujet de sa langue maternelle, le bulgare, langue qu’elle parle rarement et ne sait plus écrire, avoue-t-elle, Julia Kristeva écrit : « Je n’ai pas fait le deuil de la langue infantile au sens où un deuil "accompli" serait un détachement, une cicatrice, voire un oubli. Mais par-dessus cette crypte enfouie, sur ce réservoir stagnant qui croupit et se délite, j’ai bâti une nouvelle demeure que j’habite et qui m’habite, et dans laquelle se déroule ce qu’on pourrait appeler, non sans prétention peut-être, la vraie vie de l’esprit et de la chair. » Il va de soi que seul le temps aura permis cette connaissance intime d’une langue a priori étrangère, et voilà pourquoi il nous faut retourner aux jeunes années de Julia Kristeva.
Pour mesurer le poids collectiviste de son enfance et "admirer", au passage, sa maîtrise de la langue francaise, le mieux est de citer Julia Kristeva elle-même. Au début de l’essai qu’elle consacre à l’écrivain Colette (Le génie féminin, tome 3), inventeur à ses yeux d’un nouvel alphabet des sens, Kristeva rattache son intérêt à un certain souvenir fondateur, en Bulgarie : « je me souviens des 24 mai de mon enfance, jour de la fête de l’Alphabet cyrillique. Chargée de roses et de pivoines, soûlée de leur beauté épanouie et de leur fragrances qui me brouillaient la vue jusqu’à me faire faire perdre mes propres contours, j’arborais, à chaque défilé, une lettre différente de l’alphabet slave. J’étais une trace parmi d’autres, insérée dans une "règle [qui] guérit de tout" [Colette] - même du communisme -, et cependant disséminée parmi tous ces jeunes corps dénudés par le printemps, entrelacée dans les voix offertes aux chants antiques, dans la soie des chemises et des cheveux, et dans ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu’il en reste, s’alourdit d’un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l’alphabet avait raison de moi, tout autour de moi était l’alphabet, pourtant il n’y avait ni tout ni alphabet : rien qu’une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n’était d’aucune littérature, une sorte de vie en plus, "fraîchissante et rose", comme aurait dit Marcel Proust. »
En 1983, dans un article intitulé « Mémoire », paru dans le premier numéro de la revue L’Infini, qui naîtra des cendres de Tel Quel, Julia Kristeva a évoqué son arrivée à Paris. Sur le plan romanesque, l’épisode sera repris dans Les Samouraïs, premier roman en grande partie autobiographique, paru en 1990, et c’est alors sous les traits d’Olga Morena que Kristeva se dépeint : « Elle déposa les deux valises de cuir râpé feuille morte sur le comptoir à bagages, effleura du bout des lèvres les joues humides de papa-maman, fit à Dan un clin d’œil qu’on trouva amoureux, escalada sans se retourner la passerelle du Tupolev, passa trois heures et demie dans l’avion sans songer à égrener les minutes - la tête vide, rien que la saveur au tanin du thé dans la bouche - et atterrit dans un Paris gris, boueux. Les flocons ne cessaient de tomber et de fondre. La Ville Lumière n’existait pas, les Français ne savaient pas déblayer la neige. La déception fut totale, elle la sentit au sel dans sa gorge. Évidemment, Boris ne l’attendait pas à Orly, et elle n’avait que cinq dollars en poche. Il n’y avait pas de quoi rire. C’était la catastrophe. »

Roland Barthes et Julia Kristeva
Archéologue du langage, Julia Kristeva arpente depuis plus de trente ans les vastes palais du langage et l’univers symbolique humain sous différentes formes. On lui doit plusieurs ouvrages majeurs dans le domaine littéraire,sémiologique et linguistique, mais la grande originalité de l’oeuvre de Kristeva est sans doute la contribution psychanalytique qu’elle apporte au domaine du langage et, ce faisant, la contribution qu’elle apporte au développement de la psychanalyse par ses analyses du langage. La folie, le langage, la révolte, l’amour et le féminin demeurent ses thèmes charnières.
Elle a écrit une trilogie centrée sur le thème du «génie féminin». Trois lieux définiront ce « génie du féminin » : la vie, la folie et les mots. Trois auteures correspondent à ces trois lieux, les « plus sensibles» du XXe siècle : Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Voici comment, en introduction de son ouvrage, Julia Kristeva définit ses trois sujets:
« La vie, la folie, les mots : ces femmes s’en sont faites les exploratrices lucides et passionnées en engageant leur existence autant que leur pensée, et en éclairant pour nous d’une lumière singulière les enjeux majeurs de notre temps. »

D’un ton prophétique, Kristeva annonce une ère du féminin à venir : « le siècle prochain sera féminin pour le meilleur ou pour le pire». Le « génie », cette extraordinaire faculté qu’on accordait jadis à qui étaient bénis des dieux, s’est aujourd’hui mué en la capacité particulière à innover.
La posture de questionnement de Julia Kristeva permet d’échapper d’entrée à la tentation de conclure à une spécificité féminine du génie. Elle ne raccroche pas non plus le génie au concept d’excellence ni de supériorité et en propose d’office une définition décalée et dynamique : « Aujourd’hui, le terme de " génie " me paraît désigner des aventures paradoxales, des expériences singulières et des excès surprenants qui surgissent malgré tout dans notre univers de plus en plus standardisé. » (vol. 1, p. 8)
On comprendra ainsi que la triologie commence avec Hannah Arendt, qui a fait de cette aptitude le centre de sa théorie de l’action. Le génie est celui qui sait innover ; plus particulièrement, le génie caractérise la personne singulière dont les expériences propres, les «excès surprenants » de l’existence surgissent au-delà d’un univers de plus en plus standardisé. Historiquement, les femmes semblent avoir été rejetées de cette catégorie, en vertu de leur don spécifique de maternité.
L’expérience possible d’une « osmose avec l’espèce » différencie radicalement le genre féminin des hommes, mais cette différence justement s’ajoute aux nombreuses difficultés à manifester leur génie. Indéniablement, les mères peuvent être des génies naturels de l’amour et du dévouement, mais, plus encore, une certaine manière de vivre la vie de l’esprit leur confère un « génie bien à elles ».
C’est ce caractère binaire du génie féminin, combinant pensée et expérience, raison et sensibilité, qui orientera le projet de Kristeva.

Kristeva part d’un constat réellement avéré de différence, de place et d’évolution sociale d’une part, de construction psychique et sexuelle d’autre part, et l’illustre de faits biographiques.
Ainsi, le lecteur sera un témoin objectif des brèches de progrès que ces femmes ont ouvertes et n’en pourra que mieux mesurer l’impact par rapport à ce contexte si minutieusement décrit. Ainsi renseigné, il peut comprendre la définition réellement audacieuse que Julia Kristeva propose du génie : « L’impact de certaines œuvres ne se réduit pas à la somme de leurs éléments. Il dépend de l’incision historique qu’elles opèrent, de leurs répercussions et de leurs suites, bref de notre réception. Quelqu’un s’est trouvé à cette intersection, en a cristallisé les chances : le génie est ce sujet-là. » (vol. 1, p. 9)
Loin de l’acception divine et écrasante, le génie est proposé comme une contribution des hommes et des femmes pour et par eux-mêmes au progrès de leur condition.
Au-delà du contexte social et politique savamment illustré et exploré dans les récits (débuts de l’émancipation féminine, montée des totalitarismes, univers masculin de la psychanalyse, immoralité et légèreté de la société de la Belle Époque), elle montre comment ces femmes ont passé outre d’aussi lourds déterminismes et « n’ont pas attendu que la condition féminine soit mûre » (vol. 3, p. 543).
Partant du constat fondamental que « les femmes continueront à être les mères de l’humanité », Julia Kristeva déclare aussi qu’elles « héritent d’importantes difficultés à manifester leur génie : à construire un autre don spécifique, […] à la culture de cette humanité qu’elles abritent dans leur ventre » (vol.1, p. 13).
En cela, la révélation et l’acceptation du génie féminin relèvent encore du combat. Pourtant, « bien que puérilement lovées dans l’espace et dans l’espèce, elles peuvent agir aussi en singularités novatrices et modifier profondément la condition humaine » (vol. 1, p. 14).
Au-delà des modalités psychosociales de la condition féminine (maternité, difficulté à manifester le génie, différence, positionnement antagoniste par rapport aux hommes), au-delà de la construction psychique spécifiquement féminine, dont l’auteure ne fait pas l’économie puisqu’elle y consacre un long chapitre : « L’œdipe biface » (vol. 3, p. 545), il s’agit de sortir de l’antagonisme masculin/féminin. En effet, les génies transcendent l’histoire et le contexte dans lequel ils évoluent par leur créativité. Et c’est la singularité assumée de chaque être, homme et femme, qui lui donne toute sa mesure.
Dans un renversement de perspective audacieux, Julia Kristeva, plutôt que de déceler ce qu’il y avait de spécifiquement féminin dans la pensée de chacune d’elles, a cherché ce qu’il y avait de singulier à la lumière des données de leurs expériences de femmes et aboutit à l’idée de la plurisexualité, rendant la pensée également partageable aux hommes et aux femmes.
Dépasser la question de la spécificité, pour atteindre la singularité, qui dans son plein épanouissement de créativité ouvre l’espace du génie, telle est l’originalité de la démonstration de Julia Kristeva, dans la mesure où elle pose la personne singulière, femme ou homme, en primat, pour l’appréciation et la réception par les autres humains de sa pensée ou de ses actes. Si Julia Kristeva ne nie pas des différences, elle propose néanmoins de ne pas les stigmatiser en spécificités réductrices à l’un ou à l’autre sexe.
Tout juste parle-t-elle, par exemple, de « coloration » féminine de la pensée de Hannah Arendt comme femme, alors même que ce qui est à retenir de sa philosophie est, entre autres, son discernement face à deux totalitarismes, le nazisme et le stalinisme. Pour elle, Hannah Arendt a eu une démarche intellectuelle qui ajoute à l’universel de la pensée théorique les données de son expérience de juive et de femme.
Julia Kristeva invite ainsi à considérer les différences comme des complémentarités partageables, partant d’un accès universel aux choses de l’esprit, même si l’être humain accède à la pensée et au langage à partir d’une expérience sexuelle spécifique.
C’est pourquoi, en conclusion de son ouvrage, Julia Kristeva, dans le chapitre final « Croisements », dégage ce qui pourrait être considéré comme spécifiquement féminin dans les trois parcours.
Mais au-delà de ces spécificités, c’est ce que ces femmes ont fait d’absolument exclusif – « une version incomparable » – dans le domaine de la philosophie politique, de la psychanalyse et des lettres qui leur confère un caractère génial.
En affirmant que « l’avenir du prochain millénaire sera féminin », Julia Kristeva recueille l’idée de transcender maintenant des identités sexuelles fixées au profit de singularités, dont le plein épanouissement fera place à la créativité et qui peut mener au génie. Cette posture, cependant, n’est rendue possible que dans l’héritage du féminisme militant des différences.

[u]
Par Enigma
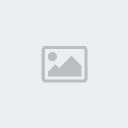
1978, au café Le Bonaparte à Paris: entre autres Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Julia Kristeva, Roland Barthes.
D'abord, il y a l'exil. L'esprit, malgré de savantes investigations, n'en viendra jamais à bout. Julia Kristeva est essayiste, romancière, enseignante et psychanalyste, mais elle est aussi quelqu'un qui, à un moment, a quitté sa terre natale, la Bulgarie.
Transmettre une langue, c’est d’abord s’adresser à des individus. Des individus qui se sont arrachés à leur milieu dans un souci d'aller ailleurs. Cette étrangeté et cette aspiration vers l'autre sont à la fois une épreuve, une douleur et une chance. Si on ne s'adresse pas à cette subjectivité de carrefour, on n'accomplit pas sa tâche technique et linguistique de transmission de la langue.
Il y a du matricide dans l'abandon de la langue maternelle. Partir, c’est couper les liens, dont le plus fondamental : le lien à la langue maternelle. Dans ce deuil infini, où la langue et le corps ressuscitent dans les battements d’un français greffé, s’abrite la mémoire maternelle. Ni involontaire ni inconsciente, je dis bien maternelle : parce qu’à la lisière des mots musiqués et des pulsions innommables, au voisinage du sens et de la biologie que l’imagination a la chance de faire exister, pour moi en français – et la souffrance me revient :
Il y a du matricide et c'est une grande douleur, mais c’est aussi un espoir de renaissance. Apprendre une langue dans le monde moderne consiste aussi à donner une réponse à cet acte d'arrachement, qui est aux portes de l'autonomie. Il faut couper des liens pour devenir un autre. La nouvelle langue devient la promesse de cette nouvelle vie. Bulgarie, ma souffrance, Julia Kristeva
(pour ceux qui auraient envie de lire ce texte si émouvant, dédié à Lydia Uldry-Natcheva, qui pourrait faire Echo à Allemagne, ma souffrance de Thomas Mann, texte auquel Kristeva fait d'ailleurs référence à la fin de Bulgarie, ma souffrance:
http://www.univ-paris-diderot.fr/rbarthes/membres/Bulgarie.pdf
La langue francaise deviendra non pas la seconde patrie de Julia Kristeva, pour reprendre une expression convenue, mais plus encore : sa « vraie vie », comme elle l’écrira dans L’Infini, dans un article intitulé Bulgarie, ma souffrance ( cité précedemment). Au sujet de sa langue maternelle, le bulgare, langue qu’elle parle rarement et ne sait plus écrire, avoue-t-elle, Julia Kristeva écrit : « Je n’ai pas fait le deuil de la langue infantile au sens où un deuil "accompli" serait un détachement, une cicatrice, voire un oubli. Mais par-dessus cette crypte enfouie, sur ce réservoir stagnant qui croupit et se délite, j’ai bâti une nouvelle demeure que j’habite et qui m’habite, et dans laquelle se déroule ce qu’on pourrait appeler, non sans prétention peut-être, la vraie vie de l’esprit et de la chair. » Il va de soi que seul le temps aura permis cette connaissance intime d’une langue a priori étrangère, et voilà pourquoi il nous faut retourner aux jeunes années de Julia Kristeva.
Pour mesurer le poids collectiviste de son enfance et "admirer", au passage, sa maîtrise de la langue francaise, le mieux est de citer Julia Kristeva elle-même. Au début de l’essai qu’elle consacre à l’écrivain Colette (Le génie féminin, tome 3), inventeur à ses yeux d’un nouvel alphabet des sens, Kristeva rattache son intérêt à un certain souvenir fondateur, en Bulgarie : « je me souviens des 24 mai de mon enfance, jour de la fête de l’Alphabet cyrillique. Chargée de roses et de pivoines, soûlée de leur beauté épanouie et de leur fragrances qui me brouillaient la vue jusqu’à me faire faire perdre mes propres contours, j’arborais, à chaque défilé, une lettre différente de l’alphabet slave. J’étais une trace parmi d’autres, insérée dans une "règle [qui] guérit de tout" [Colette] - même du communisme -, et cependant disséminée parmi tous ces jeunes corps dénudés par le printemps, entrelacée dans les voix offertes aux chants antiques, dans la soie des chemises et des cheveux, et dans ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu’il en reste, s’alourdit d’un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l’alphabet avait raison de moi, tout autour de moi était l’alphabet, pourtant il n’y avait ni tout ni alphabet : rien qu’une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n’était d’aucune littérature, une sorte de vie en plus, "fraîchissante et rose", comme aurait dit Marcel Proust. »
En 1983, dans un article intitulé « Mémoire », paru dans le premier numéro de la revue L’Infini, qui naîtra des cendres de Tel Quel, Julia Kristeva a évoqué son arrivée à Paris. Sur le plan romanesque, l’épisode sera repris dans Les Samouraïs, premier roman en grande partie autobiographique, paru en 1990, et c’est alors sous les traits d’Olga Morena que Kristeva se dépeint : « Elle déposa les deux valises de cuir râpé feuille morte sur le comptoir à bagages, effleura du bout des lèvres les joues humides de papa-maman, fit à Dan un clin d’œil qu’on trouva amoureux, escalada sans se retourner la passerelle du Tupolev, passa trois heures et demie dans l’avion sans songer à égrener les minutes - la tête vide, rien que la saveur au tanin du thé dans la bouche - et atterrit dans un Paris gris, boueux. Les flocons ne cessaient de tomber et de fondre. La Ville Lumière n’existait pas, les Français ne savaient pas déblayer la neige. La déception fut totale, elle la sentit au sel dans sa gorge. Évidemment, Boris ne l’attendait pas à Orly, et elle n’avait que cinq dollars en poche. Il n’y avait pas de quoi rire. C’était la catastrophe. »

Roland Barthes et Julia Kristeva
Archéologue du langage, Julia Kristeva arpente depuis plus de trente ans les vastes palais du langage et l’univers symbolique humain sous différentes formes. On lui doit plusieurs ouvrages majeurs dans le domaine littéraire,sémiologique et linguistique, mais la grande originalité de l’oeuvre de Kristeva est sans doute la contribution psychanalytique qu’elle apporte au domaine du langage et, ce faisant, la contribution qu’elle apporte au développement de la psychanalyse par ses analyses du langage. La folie, le langage, la révolte, l’amour et le féminin demeurent ses thèmes charnières.
Elle a écrit une trilogie centrée sur le thème du «génie féminin». Trois lieux définiront ce « génie du féminin » : la vie, la folie et les mots. Trois auteures correspondent à ces trois lieux, les « plus sensibles» du XXe siècle : Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Voici comment, en introduction de son ouvrage, Julia Kristeva définit ses trois sujets:
« La vie, la folie, les mots : ces femmes s’en sont faites les exploratrices lucides et passionnées en engageant leur existence autant que leur pensée, et en éclairant pour nous d’une lumière singulière les enjeux majeurs de notre temps. »

D’un ton prophétique, Kristeva annonce une ère du féminin à venir : « le siècle prochain sera féminin pour le meilleur ou pour le pire». Le « génie », cette extraordinaire faculté qu’on accordait jadis à qui étaient bénis des dieux, s’est aujourd’hui mué en la capacité particulière à innover.
La posture de questionnement de Julia Kristeva permet d’échapper d’entrée à la tentation de conclure à une spécificité féminine du génie. Elle ne raccroche pas non plus le génie au concept d’excellence ni de supériorité et en propose d’office une définition décalée et dynamique : « Aujourd’hui, le terme de " génie " me paraît désigner des aventures paradoxales, des expériences singulières et des excès surprenants qui surgissent malgré tout dans notre univers de plus en plus standardisé. » (vol. 1, p. 8)
On comprendra ainsi que la triologie commence avec Hannah Arendt, qui a fait de cette aptitude le centre de sa théorie de l’action. Le génie est celui qui sait innover ; plus particulièrement, le génie caractérise la personne singulière dont les expériences propres, les «excès surprenants » de l’existence surgissent au-delà d’un univers de plus en plus standardisé. Historiquement, les femmes semblent avoir été rejetées de cette catégorie, en vertu de leur don spécifique de maternité.
L’expérience possible d’une « osmose avec l’espèce » différencie radicalement le genre féminin des hommes, mais cette différence justement s’ajoute aux nombreuses difficultés à manifester leur génie. Indéniablement, les mères peuvent être des génies naturels de l’amour et du dévouement, mais, plus encore, une certaine manière de vivre la vie de l’esprit leur confère un « génie bien à elles ».
C’est ce caractère binaire du génie féminin, combinant pensée et expérience, raison et sensibilité, qui orientera le projet de Kristeva.

Kristeva part d’un constat réellement avéré de différence, de place et d’évolution sociale d’une part, de construction psychique et sexuelle d’autre part, et l’illustre de faits biographiques.
Ainsi, le lecteur sera un témoin objectif des brèches de progrès que ces femmes ont ouvertes et n’en pourra que mieux mesurer l’impact par rapport à ce contexte si minutieusement décrit. Ainsi renseigné, il peut comprendre la définition réellement audacieuse que Julia Kristeva propose du génie : « L’impact de certaines œuvres ne se réduit pas à la somme de leurs éléments. Il dépend de l’incision historique qu’elles opèrent, de leurs répercussions et de leurs suites, bref de notre réception. Quelqu’un s’est trouvé à cette intersection, en a cristallisé les chances : le génie est ce sujet-là. » (vol. 1, p. 9)
Loin de l’acception divine et écrasante, le génie est proposé comme une contribution des hommes et des femmes pour et par eux-mêmes au progrès de leur condition.
Au-delà du contexte social et politique savamment illustré et exploré dans les récits (débuts de l’émancipation féminine, montée des totalitarismes, univers masculin de la psychanalyse, immoralité et légèreté de la société de la Belle Époque), elle montre comment ces femmes ont passé outre d’aussi lourds déterminismes et « n’ont pas attendu que la condition féminine soit mûre » (vol. 3, p. 543).
Partant du constat fondamental que « les femmes continueront à être les mères de l’humanité », Julia Kristeva déclare aussi qu’elles « héritent d’importantes difficultés à manifester leur génie : à construire un autre don spécifique, […] à la culture de cette humanité qu’elles abritent dans leur ventre » (vol.1, p. 13).
En cela, la révélation et l’acceptation du génie féminin relèvent encore du combat. Pourtant, « bien que puérilement lovées dans l’espace et dans l’espèce, elles peuvent agir aussi en singularités novatrices et modifier profondément la condition humaine » (vol. 1, p. 14).
Au-delà des modalités psychosociales de la condition féminine (maternité, difficulté à manifester le génie, différence, positionnement antagoniste par rapport aux hommes), au-delà de la construction psychique spécifiquement féminine, dont l’auteure ne fait pas l’économie puisqu’elle y consacre un long chapitre : « L’œdipe biface » (vol. 3, p. 545), il s’agit de sortir de l’antagonisme masculin/féminin. En effet, les génies transcendent l’histoire et le contexte dans lequel ils évoluent par leur créativité. Et c’est la singularité assumée de chaque être, homme et femme, qui lui donne toute sa mesure.
Dans un renversement de perspective audacieux, Julia Kristeva, plutôt que de déceler ce qu’il y avait de spécifiquement féminin dans la pensée de chacune d’elles, a cherché ce qu’il y avait de singulier à la lumière des données de leurs expériences de femmes et aboutit à l’idée de la plurisexualité, rendant la pensée également partageable aux hommes et aux femmes.
Dépasser la question de la spécificité, pour atteindre la singularité, qui dans son plein épanouissement de créativité ouvre l’espace du génie, telle est l’originalité de la démonstration de Julia Kristeva, dans la mesure où elle pose la personne singulière, femme ou homme, en primat, pour l’appréciation et la réception par les autres humains de sa pensée ou de ses actes. Si Julia Kristeva ne nie pas des différences, elle propose néanmoins de ne pas les stigmatiser en spécificités réductrices à l’un ou à l’autre sexe.
Tout juste parle-t-elle, par exemple, de « coloration » féminine de la pensée de Hannah Arendt comme femme, alors même que ce qui est à retenir de sa philosophie est, entre autres, son discernement face à deux totalitarismes, le nazisme et le stalinisme. Pour elle, Hannah Arendt a eu une démarche intellectuelle qui ajoute à l’universel de la pensée théorique les données de son expérience de juive et de femme.
Julia Kristeva invite ainsi à considérer les différences comme des complémentarités partageables, partant d’un accès universel aux choses de l’esprit, même si l’être humain accède à la pensée et au langage à partir d’une expérience sexuelle spécifique.
C’est pourquoi, en conclusion de son ouvrage, Julia Kristeva, dans le chapitre final « Croisements », dégage ce qui pourrait être considéré comme spécifiquement féminin dans les trois parcours.
Mais au-delà de ces spécificités, c’est ce que ces femmes ont fait d’absolument exclusif – « une version incomparable » – dans le domaine de la philosophie politique, de la psychanalyse et des lettres qui leur confère un caractère génial.
En affirmant que « l’avenir du prochain millénaire sera féminin », Julia Kristeva recueille l’idée de transcender maintenant des identités sexuelles fixées au profit de singularités, dont le plein épanouissement fera place à la créativité et qui peut mener au génie. Cette posture, cependant, n’est rendue possible que dans l’héritage du féminisme militant des différences.

[u]
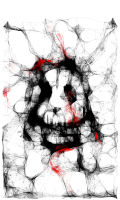
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Si tu pouvais arrêter de bricoler ce forum (je sais que c'est le tien, mais quand même, y'a des limites!), et éviter de nous casser la rampe...
Invité- Invité
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Nous attendons tes interventions avec impatience! Tu peux marcher sans rampe à ton âge ou je prévois l'ascenseur...?
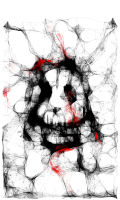
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
C'est féminin, une charge...
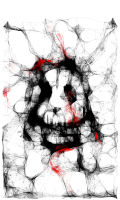
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Dictature Verbati?!
Dictature Verbati?!
Verbatim:
1. En effet c'est le forum de Kashima donc, libre à elle de bricoler ce qu'elle veut dans la mesure où elle ne censure personne! Ce qu'elle n'a jamais fait et ne fera jamais avec son âme oh combien démocratique ( à mon triste regret!)... sa tolérance et sa patience face aux attaques, provocations, au harcèlement....
2. Où est ton problème?! De ne plus faire la UNE? Ton article sur l'empalement a été plusieurs jours en première page car il s'inscrivait dans une thématique que Kashima a voulu mettre en exergue, qui était un bel Echo à son article sur l'empaillement. Est-ce que qn. s'en est plaint?!
3. Varier, actualiser, dé-placer la thématique, dé-centrer, ouvrir sur d'autres horizons, n'est-ce pas rendre vivant?!
4. Et c'est le ton qui fait la chanson! Entre critiquer une oeuvre/ un auteur et attaquer personnellement qn. avec agressivité, il y a un monde!
Dès le début, tu me provoques et pourquoi? Bizarrement, ta facon d'agir ne m'est pas étrangère. Tu me rappelles qn.
Je me suis attaquée à Yourcenar et non pas à toi, sans connaître tes goûts comme je le fais avec Kashima et d'autres ( cf. ma critique à son article La femme des sables). Je suis loin de partager tous les goûts de Kashima: Biolay, Murat, Said, Nothomb...pas du tout mon goût et elle le sait! Un dialogue, un débat, une confrontation n'est pas synonyme d'AGRESSION!
Pour finir, ne t'avise surtout pas à prendre le ton que tu prends avec Kashima, avec moi! Je n'ai ni sa patience ni sa diplomatie!
1. En effet c'est le forum de Kashima donc, libre à elle de bricoler ce qu'elle veut dans la mesure où elle ne censure personne! Ce qu'elle n'a jamais fait et ne fera jamais avec son âme oh combien démocratique ( à mon triste regret!)... sa tolérance et sa patience face aux attaques, provocations, au harcèlement....
2. Où est ton problème?! De ne plus faire la UNE? Ton article sur l'empalement a été plusieurs jours en première page car il s'inscrivait dans une thématique que Kashima a voulu mettre en exergue, qui était un bel Echo à son article sur l'empaillement. Est-ce que qn. s'en est plaint?!
3. Varier, actualiser, dé-placer la thématique, dé-centrer, ouvrir sur d'autres horizons, n'est-ce pas rendre vivant?!
4. Et c'est le ton qui fait la chanson! Entre critiquer une oeuvre/ un auteur et attaquer personnellement qn. avec agressivité, il y a un monde!
Dès le début, tu me provoques et pourquoi? Bizarrement, ta facon d'agir ne m'est pas étrangère. Tu me rappelles qn.
Je me suis attaquée à Yourcenar et non pas à toi, sans connaître tes goûts comme je le fais avec Kashima et d'autres ( cf. ma critique à son article La femme des sables). Je suis loin de partager tous les goûts de Kashima: Biolay, Murat, Said, Nothomb...pas du tout mon goût et elle le sait! Un dialogue, un débat, une confrontation n'est pas synonyme d'AGRESSION!
Pour finir, ne t'avise surtout pas à prendre le ton que tu prends avec Kashima, avec moi! Je n'ai ni sa patience ni sa diplomatie!
Invité- Invité
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Tu réponds à Enigma en t'adressant à moi?
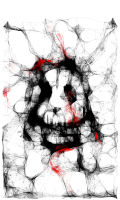
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 Re: Ecriture de l'exil
Re: Ecriture de l'exil
Bein oui, c'est bien toi que je harcèle. Et si je comprends bien le message d'Enigma, tu es trop "démocratique" et patiente pour oser me le dire.
Invité- Invité
 Casser la rampe?
Casser la rampe?
Oh cela me fait penser au film Sunset Boulevard! Le déclin d'une star, "cassée"/ brisée qui voudrait "remonter la rampe", en vain!