Dans l'enfer des abattoirs
Page 1 sur 1
 Dans l'enfer des abattoirs
Dans l'enfer des abattoirs
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
« On utilise tout dans le cochon, sauf son cri » : telle est la devise capitaliste chez Brown and Company. En racontant ce qui se passe à Packingtown, ce vaste quartier de Chicago comprenant les parcs à bestiaux, les abattoirs et les logements des ouvriers, Upton Sinclair va connaître son premier grand succès littéraire. L’auteur, qui rendra fous de colère les cartels, mais que son envie de réforme porte au combat, sera même reçu par Roosevelt à la Maison-Blanche.
La Jungle s’ouvre sur le mariage d’Ona et de Jurgis : on s’amuse, on danse, on mange… Mais la fête a coûté d’importants sacrifices et la liesse cache quelque chose de douloureux et de misérable :
« Elles sont effrayantes, quand on y songe, les dépenses qu’exige cette noce. C’est follement imprudent et c’est tragique, mais c’est tellement beau ! Peu à peu, ces pauvres gens ont tout perdu. Mais ils sont attachés à la vesejila, ils s’y accrochent de toute la force de leur âme ». (p.24)
Dans cette scène inaugurale, antithèse de ce que sera la vie des personnages, l’auteur annonce la tragédie d’une famille lituanienne qui se débattra pour ne pas sombrer dans le malheur total. Comme dans un roman naturaliste, Upton Sinclair nous narre l’histoire de Lituaniens, qui vendent tout ce qu’ils possèdent pour partir, espérant sortir de la misère et vivre le rêve américain. Ils sont douze à prendre le bateau pour cette nouvelle terre : Jurgis, Antanas (son père), Ona (sa fiancée) Elzbieta (belle-mère d’Ona), Jonas (frère d’Elzbieta) et les six enfants de celle-ci. Ils quittent leur pays natal le cœur rempli d’un espoir qui sera long à s’éteindre. Dès leur arrivée, ils sont freinés par la barrière de la langue. Heureusement, ils trouvent sur place des compatriotes qui les aident autant qu’ils le peuvent, leur donnent de quoi dormir et manger en attendant d’obtenir du travail.
À Chicago, à la fin du XIXème siècle, l’industrie de la viande est en pleine expansion : des abattoirs à perte de vue, des conserveries, une machine à tuer des milliers de bêtes par jour ! Lorsqu’on entre dans l’usine, on croirait lire la description de ce qui se déroule de nos jours dans les élevages industriels et les abattages à la chaîne, tels qu’on en a vu récemment grâce aux vidéos de L214, avec des ouvriers qui considèrent les animaux comme de la marchandise. Chacun est assigné à sa tâche : il y a celui qui assomme, celui qui écorche, celui qui balaie les boyaux, etc. La première fois que Jurgis et sa famille pénètrent au cœur des abattoirs pour une simple visite, ce ne sont que stupeur et dégoût :
« Les spectateurs sursautèrent d’effroi, les femmes pâlirent en se reculant : un cri atroce venait de leur percer les oreilles. Il fut suivi d’un autre, plus fort et plus angoissant encore. Le cochon avait entamé son voyage sans retour. » (p. 55)
S’ensuit une description de la roue à laquelle les animaux sont pendus avant d’être saignés. Mais, comme tous les autres, les spectateurs s’habituent, ravalent leur peur, passent leur chemin. Malgré des pages très fortes et brutales sur le sort réservé aux bêtes, le roman d’Upton Sinclair n’est pas réellement engagé sur cette question. En tant qu’écrivain-journaliste, s’il dénonce ces horreurs, c’est pour mieux mettre en lumière les rudes conditions de travail des hommes, exploités par des patrons sans foi ni loi et cupides. La cruauté envers les animaux n’est qu’une métaphore de l’existence pitoyable des travailleurs. En 1906, la conscience de ce que leur fait subir l’être humain n’a pas éclos. Upton s’intéresse à la condition de l’homme, à la grosse mécanique qui le happe et le broie : qu’il patauge dans le sang ou respire les phosphates des usines à engrais, c’est son malheur qui est mis en valeur, comme le fait qu’il puisse, déjà à cette époque, manger n’importe quoi :
« Sortaient aussi de chez Durham (…) du pâté de jambon qui était préparé à base de rognures de viande de bœuf fumé trop petites pour être tranchées mécaniquement, de tripes colorées chimiquement pour leur ôter leur blancheur, de rognures de jambon et de corned beef, de pommes de terre non épluchées et enfin de bouts d’œsophages durs et cartilagineux que l’on récupérait une fois qu’on avait coupé les langues de bœuf. » (p.147)
Dans la fabrique de chair à saucisses, il n’est pas rare de voir des rats partir au broyage ; il y a même des ouvriers qui disparaissent mystérieusement — un accident suffit à les faire entrer dans la préparation du « saindoux cent pour cent pur porc de chez Durham » … Ce qui est effrayant, dans ce livre écrit au début du XXe siècle, c’est la modernité de ce qui y est décrit, que ce soit sur le sort des animaux, les excès du capitalisme ou la nourriture industrielle.
Toute la famille parvient à trouver un travail, même si les journées sont longues, difficiles et mal payées. Jurgis, la fleur au fusil, se démène, sûr de sa jeunesse et de sa force que rien ne pourra arrêter. Dans les premiers temps, les membres de la famille décident, suite à une petite annonce, de devenir propriétaire d’une maison neuve, car ils estiment qu’ils ne verseront pas un loyer pour rien. Or le malheur les attend à chaque pas : la demeure s’avère être un taudis que les vendeurs avaient maquillé, les versements plus chers que prévus. Les hivers sont abominables, les étés insupportables, et chacun lutte pour sa survie. La Jungle est une terrible descente aux Enfers : on suit le destin de ces étrangers pleins de rêves, que la vie malmène, qui tombent malades, agonisent, mais continuent à garder espoir. Chaque moment heureux est suivi d’un échec cuisant : par exemple, Jurgis peut enfin se marier avec Ona ; ils ont un enfant, mais Ona est atteinte d’une métrite qui la fait souffrir et qui empire. Leur existence est truffée d’accidents, de trahisons, de tristesse. On s’attache à eux, mais on est miné par de telles horreurs qui feraient passer les personnages les plus misérables de Zola pour des nantis. Upton Sinclair nous fait voir tous les visages de la pauvreté humaine, mâchée, avalée par la grande ville industrielle qu’est Chicago. Il n’y a aucune verdure ; les gens vivent sur des tas d’ordures, marchent dans des rues insalubres. La mauvaise odeur, les maladies, la prostitution, l’alcoolisme font des ravages. Tout homme est destiné à mourir piteusement, même s’il lutte.
Et un jour, alors que sa femme Ona est morte en couches, éventrée par le bébé qui se présentait par l’épaule, que son fils qu’il chérissait tant a péri noyé dans un torrent de boue, Jurgis décide d’abandonner ceux qui restent. Il est tenté de quitter cette famille qui est devenue un véritable poids pour lui et cède à la tentation de l’évasion, pensant qu’il s’en sortira mieux seul. Pour montrer la force du socialisme qu’il défend, Upton Sinclair en vient à isoler cet homme qui, paradoxalement, sans prise de conscience individuelle, ne pourra pas s’en sortir. On songe aux futurs récits de George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres ou Et vive l’aspidistra ! où l’on peut être témoin de la même misère, mais aussi de la même perspective de salut par la politique. J’ai lu La Jungle, paru d’abord en feuilleton dans le journal socialiste Appeal to reason, sans rien savoir de cet écrivain très investi politiquement. La force de son engagement est incroyable ; elle explose dans les cinquante dernières pages du livre qui vire au pamphlet socialiste. Le roman disparaît au profit d’un essai politique plein d’enthousiasme. Il n’est même plus question de Jurgis, le personnage principal, qui trouve enfin sa voie en se fondant dans la foule des activistes : le « je » se transforme en « nous ». Ce n’est pas le « nous » du noyau familial », mais celui du combat. Il faut s’oublier soi-même pour penser au monde. La misère et le malheur peuvent être vaincus, et le livre se termine sur cette clameur, cette illumination collective :
« Alors se rallieront à notre étendard tous les travailleurs outragés (…) ! Nous les organiserons, nous les disciplinerons, nous les conduirons à la victoire ! Nous briserons la résistance, nous balaierons tout devant nous et Chicago sera à nous ! Chicago sera à nous ! CHICAGO SERA À NOUS ! »
Céline Maltère
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]« On utilise tout dans le cochon, sauf son cri » : telle est la devise capitaliste chez Brown and Company. En racontant ce qui se passe à Packingtown, ce vaste quartier de Chicago comprenant les parcs à bestiaux, les abattoirs et les logements des ouvriers, Upton Sinclair va connaître son premier grand succès littéraire. L’auteur, qui rendra fous de colère les cartels, mais que son envie de réforme porte au combat, sera même reçu par Roosevelt à la Maison-Blanche.
La Jungle s’ouvre sur le mariage d’Ona et de Jurgis : on s’amuse, on danse, on mange… Mais la fête a coûté d’importants sacrifices et la liesse cache quelque chose de douloureux et de misérable :
« Elles sont effrayantes, quand on y songe, les dépenses qu’exige cette noce. C’est follement imprudent et c’est tragique, mais c’est tellement beau ! Peu à peu, ces pauvres gens ont tout perdu. Mais ils sont attachés à la vesejila, ils s’y accrochent de toute la force de leur âme ». (p.24)
Dans cette scène inaugurale, antithèse de ce que sera la vie des personnages, l’auteur annonce la tragédie d’une famille lituanienne qui se débattra pour ne pas sombrer dans le malheur total. Comme dans un roman naturaliste, Upton Sinclair nous narre l’histoire de Lituaniens, qui vendent tout ce qu’ils possèdent pour partir, espérant sortir de la misère et vivre le rêve américain. Ils sont douze à prendre le bateau pour cette nouvelle terre : Jurgis, Antanas (son père), Ona (sa fiancée) Elzbieta (belle-mère d’Ona), Jonas (frère d’Elzbieta) et les six enfants de celle-ci. Ils quittent leur pays natal le cœur rempli d’un espoir qui sera long à s’éteindre. Dès leur arrivée, ils sont freinés par la barrière de la langue. Heureusement, ils trouvent sur place des compatriotes qui les aident autant qu’ils le peuvent, leur donnent de quoi dormir et manger en attendant d’obtenir du travail.
À Chicago, à la fin du XIXème siècle, l’industrie de la viande est en pleine expansion : des abattoirs à perte de vue, des conserveries, une machine à tuer des milliers de bêtes par jour ! Lorsqu’on entre dans l’usine, on croirait lire la description de ce qui se déroule de nos jours dans les élevages industriels et les abattages à la chaîne, tels qu’on en a vu récemment grâce aux vidéos de L214, avec des ouvriers qui considèrent les animaux comme de la marchandise. Chacun est assigné à sa tâche : il y a celui qui assomme, celui qui écorche, celui qui balaie les boyaux, etc. La première fois que Jurgis et sa famille pénètrent au cœur des abattoirs pour une simple visite, ce ne sont que stupeur et dégoût :
« Les spectateurs sursautèrent d’effroi, les femmes pâlirent en se reculant : un cri atroce venait de leur percer les oreilles. Il fut suivi d’un autre, plus fort et plus angoissant encore. Le cochon avait entamé son voyage sans retour. » (p. 55)
S’ensuit une description de la roue à laquelle les animaux sont pendus avant d’être saignés. Mais, comme tous les autres, les spectateurs s’habituent, ravalent leur peur, passent leur chemin. Malgré des pages très fortes et brutales sur le sort réservé aux bêtes, le roman d’Upton Sinclair n’est pas réellement engagé sur cette question. En tant qu’écrivain-journaliste, s’il dénonce ces horreurs, c’est pour mieux mettre en lumière les rudes conditions de travail des hommes, exploités par des patrons sans foi ni loi et cupides. La cruauté envers les animaux n’est qu’une métaphore de l’existence pitoyable des travailleurs. En 1906, la conscience de ce que leur fait subir l’être humain n’a pas éclos. Upton s’intéresse à la condition de l’homme, à la grosse mécanique qui le happe et le broie : qu’il patauge dans le sang ou respire les phosphates des usines à engrais, c’est son malheur qui est mis en valeur, comme le fait qu’il puisse, déjà à cette époque, manger n’importe quoi :
« Sortaient aussi de chez Durham (…) du pâté de jambon qui était préparé à base de rognures de viande de bœuf fumé trop petites pour être tranchées mécaniquement, de tripes colorées chimiquement pour leur ôter leur blancheur, de rognures de jambon et de corned beef, de pommes de terre non épluchées et enfin de bouts d’œsophages durs et cartilagineux que l’on récupérait une fois qu’on avait coupé les langues de bœuf. » (p.147)
Dans la fabrique de chair à saucisses, il n’est pas rare de voir des rats partir au broyage ; il y a même des ouvriers qui disparaissent mystérieusement — un accident suffit à les faire entrer dans la préparation du « saindoux cent pour cent pur porc de chez Durham » … Ce qui est effrayant, dans ce livre écrit au début du XXe siècle, c’est la modernité de ce qui y est décrit, que ce soit sur le sort des animaux, les excès du capitalisme ou la nourriture industrielle.
Toute la famille parvient à trouver un travail, même si les journées sont longues, difficiles et mal payées. Jurgis, la fleur au fusil, se démène, sûr de sa jeunesse et de sa force que rien ne pourra arrêter. Dans les premiers temps, les membres de la famille décident, suite à une petite annonce, de devenir propriétaire d’une maison neuve, car ils estiment qu’ils ne verseront pas un loyer pour rien. Or le malheur les attend à chaque pas : la demeure s’avère être un taudis que les vendeurs avaient maquillé, les versements plus chers que prévus. Les hivers sont abominables, les étés insupportables, et chacun lutte pour sa survie. La Jungle est une terrible descente aux Enfers : on suit le destin de ces étrangers pleins de rêves, que la vie malmène, qui tombent malades, agonisent, mais continuent à garder espoir. Chaque moment heureux est suivi d’un échec cuisant : par exemple, Jurgis peut enfin se marier avec Ona ; ils ont un enfant, mais Ona est atteinte d’une métrite qui la fait souffrir et qui empire. Leur existence est truffée d’accidents, de trahisons, de tristesse. On s’attache à eux, mais on est miné par de telles horreurs qui feraient passer les personnages les plus misérables de Zola pour des nantis. Upton Sinclair nous fait voir tous les visages de la pauvreté humaine, mâchée, avalée par la grande ville industrielle qu’est Chicago. Il n’y a aucune verdure ; les gens vivent sur des tas d’ordures, marchent dans des rues insalubres. La mauvaise odeur, les maladies, la prostitution, l’alcoolisme font des ravages. Tout homme est destiné à mourir piteusement, même s’il lutte.
Et un jour, alors que sa femme Ona est morte en couches, éventrée par le bébé qui se présentait par l’épaule, que son fils qu’il chérissait tant a péri noyé dans un torrent de boue, Jurgis décide d’abandonner ceux qui restent. Il est tenté de quitter cette famille qui est devenue un véritable poids pour lui et cède à la tentation de l’évasion, pensant qu’il s’en sortira mieux seul. Pour montrer la force du socialisme qu’il défend, Upton Sinclair en vient à isoler cet homme qui, paradoxalement, sans prise de conscience individuelle, ne pourra pas s’en sortir. On songe aux futurs récits de George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres ou Et vive l’aspidistra ! où l’on peut être témoin de la même misère, mais aussi de la même perspective de salut par la politique. J’ai lu La Jungle, paru d’abord en feuilleton dans le journal socialiste Appeal to reason, sans rien savoir de cet écrivain très investi politiquement. La force de son engagement est incroyable ; elle explose dans les cinquante dernières pages du livre qui vire au pamphlet socialiste. Le roman disparaît au profit d’un essai politique plein d’enthousiasme. Il n’est même plus question de Jurgis, le personnage principal, qui trouve enfin sa voie en se fondant dans la foule des activistes : le « je » se transforme en « nous ». Ce n’est pas le « nous » du noyau familial », mais celui du combat. Il faut s’oublier soi-même pour penser au monde. La misère et le malheur peuvent être vaincus, et le livre se termine sur cette clameur, cette illumination collective :
« Alors se rallieront à notre étendard tous les travailleurs outragés (…) ! Nous les organiserons, nous les disciplinerons, nous les conduirons à la victoire ! Nous briserons la résistance, nous balaierons tout devant nous et Chicago sera à nous ! Chicago sera à nous ! CHICAGO SERA À NOUS ! »
Céline Maltère
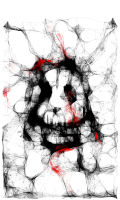
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
 La Vache, Beat Sterchi
La Vache, Beat Sterchi
Un autre livre qui traite de l'enfer des abattoirs :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La Vache de Beat Sterchi : passer l’envie de steak…
Blösch, titre original de La Vache, a été publié en 1983 et a rencontré, à l’époque de sa sortie, un immense succès. Beat Sterchi, auteur suisse né en 1949, qui ne faisait pas du tout partie du milieu littéraire, a vu son roman salué par la critique et recevoir plusieurs prix. Pourtant, il a mal vécu ce succès, percevant dans les louanges qui lui étaient faites sur son style une manière de voiler le contenu du livre :
« On parlait de la véhémence de ma langue pour taire la véhémence de ce dont je parlais ».
Interview de Beat Sterchi par Daniel Rothenbülher pour Viceversa
Les éditions suisses Zoé ont réédité ce texte qui avait connu une première traduction française en 1987. Ce qui frappe d’abord, c’est le caractère visionnaire de ce roman qui reparaît aujourd’hui, à un moment où l’on s’interroge davantage sur l’élevage industriel et ce qui se passe d’inhumain dans les abattoirs. Beat Sterchi avait déjà senti comment le productivisme et le progrès allaient nuire à l’élevage et au bien-être animal. Ainsi, l’un de ses personnages s’exclame :
« Le progrès. Tu parles. Le progrès ! La marche vers la mort ! »
Il serait donc impossible au lecteur mal intentionné (et très carnivore ?) de critiquer ce livre en criant au prosélytisme végan, à l’égoïsme végétarien, car ce n’est pas du tout le sujet de La Vache, et son écriture a pour contexte les années 80 où l’on n’avait pas encore entamé vraiment les réflexions actuelles sur l’industrialisation de l’élevage. De plus, on peut accorder un grand crédit à Beat Sterchi, qui sait de quoi il parle, puisqu’il a lui-même travaillé dans les abattoirs et que son père était boucher.
Dans la ferme de Knuchel, on attend l’Espagnol, Ambrosio. Les douze vaches de Hans, leur propriétaire, donnent beaucoup de lait. Il est hors de question pour lui de céder à la pression du progrès technologique : si tous ses voisins décident un par un de tomber dans la facilité des machines à traire, lui s’y refuse. Ses vaches, il les élève et les trait lui-même, il les laisse au pâturage, il leur offre une vie de vache. Il les connaît toutes, toutes ont leur prénom et il sait leur caractère. La reine de l’étable, c’est Blösch, « la meilleure vache de l’alpage » :
« La plus belle vache du village, oui, ils n’en ont pas de pareille dans leurs écuries, ces messieurs, ils n’ont que des unités de gros bétail ! »
Au village, on voit l’arrivée de l’Espagnol d’un très mauvais œil. On se méfie des étrangers... Au café, les discussions dégénèrent souvent par méchanceté ou jalousie. Knuchel produit des litres de lait, et son ouvrier Ambrosio, très doué, est irréprochable :
« Si vos petites machines qui font tic-tac vous amusent, tant mieux, mais foutez-moi la paix avec ça ! Vous n’avez pas mieux à faire que de vous vanter avec vos suceurs à lait ?
Là-dessus, le fromager retira son cigare de la bouche, laissa pendre son bras avec les cartes, se retourna vers Knuchel :
— Il y en a qui ont des machines à traire, et il y en a qui ont des étrangers ! »
Mais, à la quarante-neuvième page, alors que le lecteur suivait le quotidien du fermier et d’Ambrosio, il se retrouve soudain avec un autre narrateur, un « je » très tourmenté. Et il se rend très vite compte qu’il est au cœur d’un abattoir !
J’ai déjà parlé ici de La Jungle d’Upton Sinclair (http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/les-anciens-et-les-modernes/content/1947024-la-jungle-d-upton-sinclair-un-cauchemar-moderne), qui décrivait les usines à tuer dans l’Amérique du début du XXème siècle, à Chicago, l’horreur de l’industrialisation de la mort : avec La Vache, on est dans la tête de cet apprenti qui souffre et se pose mille questions sur sa présence dans ce lieu. Il cauchemarde, ne sait pas s’y prendre tout à fait bien parmi les tripiers, les saigneurs et autres collègues qui pataugent toute la journée dans le sang et les sécrétions des vaches abattues. L’auteur décrit sans concessions les étapes de l’abattage, ne reculant pas devant la réalité : qui aurait l’hypocrisie de parler avec de jolis mots des tueries et des dépeçages ?
« Retour au travail.
Avec des couteaux aiguisés.
Les mains de Buri palpaient les intestins. Des mains sensibles comme celles d’un aveugle tiraient un peu ici, pressaient là, contrôlaient, souples comme des serpents sur la fraise étalée à même la table de bois. C’était la sixième de la journée. Elle n’était pas mal. Intestin grêle et côlon étaient fermes, assez solides pour des cervelas et des saucisses. (…) Les derniers 75 cm du gros intestin sont ajoutés aux tripes. Buri mesura. Un coup de couteau. Rectum et anus furent expédiés dans un bassin, et Buri se mit en position : il avança une botte, se baissa et se mit à vider l’intestin grêle, qui fait 40 m, dans un seau en plastique. En mouvements réguliers, il passait ce long tuyau sur sa lame pour le séparer de la fraise. À chaque mouvement du bras, il hochait la tête, fronçait le sourcil. Il se concentrait sur le couteau. La moindre inattention, et tout le boyau est fichu. Buri transpirait. Il s’essuya le front de son avant-bras. Il avait passé. Il rangea le couteau à boyaux et pénétra à mains nues dans les restes graisseux de l’intérieur de la sixième vache. »
On est extrêmement étonné quand on croise tout à coup parmi les employés de l’abattoir Ambrosio, l’Espagnol qui prenait soin des vaches chez Knuchel ! Qu’a-t-il pu se passer pour que cet ouvrier dévoué à la ferme se retrouve dans cet abattoir ? Que veut nous dire cette ellipse temporelle ? Le roman sera bâti ainsi : il alternera entre les moments à la ferme, dans la verdure de l’alpage, et ceux à l’abattoir, le lecteur cherchant à comprendre ce qui a conduit l’employé modèle en enfer.
Le comble de l’horreur est atteint quand Ambrosio reconnaît parmi les futures victimes la reine de Knuchel, cette vache qu’on respectait, qui s’imposait parmi les autres et suscitait l’envie : Blösch, décharnée, tient à peine sur ses pattes et sera bientôt une carcasse. Comment accepter de participer à sa mort ou d’en être témoin après tout ce qui les a liés ?
L’un des moments les plus difficiles, que je reproduis ici, est celui où l’apprenti se retrouve face à Blösch qui résiste et ne veut pas mourir. Pourquoi ? Est-elle inspirée par le diable ?
« La vache s’agite. Elle résiste, s’obstine, en dépit du trou dans son front. Les rares muscles de son corps se tendent. Elle se tortille.
Je lutte pour mon équilibre.
Car le Seigneur est une ombre sur ta main droite.
Attention, le couteau.
Mon verset de confirmation.
Je sens cette force sous moi.
Le cou veut se dresser et battre comme la nageoire caudale d’un poisson en train de crever.
Je plante ma botte en caoutchouc.
Concentre-toi !
Et je plante mon couteau.
Au premier coup, je rate la carotide, au second aussi, pour ne l’attraper qu’au troisième essai. Le rouge jaillit, expulsé vers la lumière à grands coups de pompe du cœur. Elle a une quantité anormale de…
Sous moi, le tremblement du cou s’accentue.
Un gémissement, un râle tremblant dans la trachée, un frémissement, une forte secousse : d’un bond je me lève.
Loin.
La vache dresse la tête. Tout branle, tremble : elle hisse sa carcasse sur ses pattes de devant, veut se lever.
Les naseaux dégouttant de rouge, elle trompette à travers les abattoirs. Assise, elle dodeline de la tête et du cou, de droite à gauche, de gauche à droite, et une fois encore de droite à gauche.
Je recule.
Le sang s’écoule de sa blessure au cou.
Fierté des cornes. Les bois de la vache.
Je me colle au mur, le couteau de boucher tendu loin de moi.
Et voici que la vache s’affaisse ; au bout de ses forces nerveuses, elle gît dans son sang, épuisée.
Piccolo me fixe.
Tout va bien. Les esprits sont chassés.
Personne n’a interrompu son travail.
C’est Kilchenmann qui avait juste oublié de passer par le trou le long fil de fer à planter dans la moelle.
Trop peu détruite.
Le sang se retire de ma tête.
Je ferme les yeux, glisse, le dos au mur ; accroupi, j’essaie de ne penser à rien. »
Le roman mélange les styles : plutôt classique dans sa narration, il laisse parfois place à un langage plus parlé lorsque l’apprenti s’interroge ou que les employés de l’abattoir se livrent à des discussions au moment de la pause. La forme est souvent plus saccadée, comme ci-dessus, lorsque c’est l’apprenti qui monologue mentalement.
En juin dernier, le grand public semblait découvrir l’existence des vaches à hublot, révélée par une enquête de L214. Et pourtant, à la page 146 de La Vache, on lit :
« Récemment, il était allé à l’hospice vétérinaire, et pour lui montrer quelque chose, le vétérinaire lui avait fait enfiler des bottes spéciales et mettre un tablier de caoutchouc. Et puis il l’avait conduit dans une étable expérimentale. Là, il y avait une jeune vache qui avait une véritable fenêtre sur le côté du ventre, si bien qu’on pouvait voir l’intérieur de la panse : on voyait l’herbe très distinctement.
— Sacré vingt dieux, rigola Knuchel, ces messieurs les docteurs ne savaient donc pas que ce qu’une vache a dans la panse, c’est à peu près ce qu’elle a mangé ? »
Ce roman laisse entendre que les vaches, tout heureuses qu’elles puissent être durant leur élevage dans certaines propriétés (pensée welfariste avant l’heure) ne sont pas là pour faire joli dans les champs et qu’au bout du compte, vaches à lait ou pas, elles mourront rarement de leur belle mort. Mais La Vache dénonce surtout la mécanisation de l’élevage et les conditions sociales des employés d’abattoir, sans éveiller particulièrement de pitié pour ces hommes (c’est un milieu masculin), sans en faire des monstres non plus (bien que l’acceptation d’exercer ce métier, même au fond de la misère, au fond du trou, me semble toujours révoltante et incompréhensible). S’il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre tous les détails de la chaîne d’abattage (section vache, taureau et veau), la lecture de La Vache paraît indispensable, et pas seulement aux convaincus. La viande ne vient pas de nulle part, elle ne pousse pas sous cellophane ; elle a été un être sensible… À vous passer l’envie de steak.
Céline Maltère
La Vache, Beat Sterchi, éditions Zoé, avril 2019 (14 euros).
Article pour Le Salon littéraire
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La Vache de Beat Sterchi : passer l’envie de steak…
Blösch, titre original de La Vache, a été publié en 1983 et a rencontré, à l’époque de sa sortie, un immense succès. Beat Sterchi, auteur suisse né en 1949, qui ne faisait pas du tout partie du milieu littéraire, a vu son roman salué par la critique et recevoir plusieurs prix. Pourtant, il a mal vécu ce succès, percevant dans les louanges qui lui étaient faites sur son style une manière de voiler le contenu du livre :
« On parlait de la véhémence de ma langue pour taire la véhémence de ce dont je parlais ».
Interview de Beat Sterchi par Daniel Rothenbülher pour Viceversa
Les éditions suisses Zoé ont réédité ce texte qui avait connu une première traduction française en 1987. Ce qui frappe d’abord, c’est le caractère visionnaire de ce roman qui reparaît aujourd’hui, à un moment où l’on s’interroge davantage sur l’élevage industriel et ce qui se passe d’inhumain dans les abattoirs. Beat Sterchi avait déjà senti comment le productivisme et le progrès allaient nuire à l’élevage et au bien-être animal. Ainsi, l’un de ses personnages s’exclame :
« Le progrès. Tu parles. Le progrès ! La marche vers la mort ! »
Il serait donc impossible au lecteur mal intentionné (et très carnivore ?) de critiquer ce livre en criant au prosélytisme végan, à l’égoïsme végétarien, car ce n’est pas du tout le sujet de La Vache, et son écriture a pour contexte les années 80 où l’on n’avait pas encore entamé vraiment les réflexions actuelles sur l’industrialisation de l’élevage. De plus, on peut accorder un grand crédit à Beat Sterchi, qui sait de quoi il parle, puisqu’il a lui-même travaillé dans les abattoirs et que son père était boucher.
Dans la ferme de Knuchel, on attend l’Espagnol, Ambrosio. Les douze vaches de Hans, leur propriétaire, donnent beaucoup de lait. Il est hors de question pour lui de céder à la pression du progrès technologique : si tous ses voisins décident un par un de tomber dans la facilité des machines à traire, lui s’y refuse. Ses vaches, il les élève et les trait lui-même, il les laisse au pâturage, il leur offre une vie de vache. Il les connaît toutes, toutes ont leur prénom et il sait leur caractère. La reine de l’étable, c’est Blösch, « la meilleure vache de l’alpage » :
« La plus belle vache du village, oui, ils n’en ont pas de pareille dans leurs écuries, ces messieurs, ils n’ont que des unités de gros bétail ! »
Au village, on voit l’arrivée de l’Espagnol d’un très mauvais œil. On se méfie des étrangers... Au café, les discussions dégénèrent souvent par méchanceté ou jalousie. Knuchel produit des litres de lait, et son ouvrier Ambrosio, très doué, est irréprochable :
« Si vos petites machines qui font tic-tac vous amusent, tant mieux, mais foutez-moi la paix avec ça ! Vous n’avez pas mieux à faire que de vous vanter avec vos suceurs à lait ?
Là-dessus, le fromager retira son cigare de la bouche, laissa pendre son bras avec les cartes, se retourna vers Knuchel :
— Il y en a qui ont des machines à traire, et il y en a qui ont des étrangers ! »
Mais, à la quarante-neuvième page, alors que le lecteur suivait le quotidien du fermier et d’Ambrosio, il se retrouve soudain avec un autre narrateur, un « je » très tourmenté. Et il se rend très vite compte qu’il est au cœur d’un abattoir !
J’ai déjà parlé ici de La Jungle d’Upton Sinclair (http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/les-anciens-et-les-modernes/content/1947024-la-jungle-d-upton-sinclair-un-cauchemar-moderne), qui décrivait les usines à tuer dans l’Amérique du début du XXème siècle, à Chicago, l’horreur de l’industrialisation de la mort : avec La Vache, on est dans la tête de cet apprenti qui souffre et se pose mille questions sur sa présence dans ce lieu. Il cauchemarde, ne sait pas s’y prendre tout à fait bien parmi les tripiers, les saigneurs et autres collègues qui pataugent toute la journée dans le sang et les sécrétions des vaches abattues. L’auteur décrit sans concessions les étapes de l’abattage, ne reculant pas devant la réalité : qui aurait l’hypocrisie de parler avec de jolis mots des tueries et des dépeçages ?
« Retour au travail.
Avec des couteaux aiguisés.
Les mains de Buri palpaient les intestins. Des mains sensibles comme celles d’un aveugle tiraient un peu ici, pressaient là, contrôlaient, souples comme des serpents sur la fraise étalée à même la table de bois. C’était la sixième de la journée. Elle n’était pas mal. Intestin grêle et côlon étaient fermes, assez solides pour des cervelas et des saucisses. (…) Les derniers 75 cm du gros intestin sont ajoutés aux tripes. Buri mesura. Un coup de couteau. Rectum et anus furent expédiés dans un bassin, et Buri se mit en position : il avança une botte, se baissa et se mit à vider l’intestin grêle, qui fait 40 m, dans un seau en plastique. En mouvements réguliers, il passait ce long tuyau sur sa lame pour le séparer de la fraise. À chaque mouvement du bras, il hochait la tête, fronçait le sourcil. Il se concentrait sur le couteau. La moindre inattention, et tout le boyau est fichu. Buri transpirait. Il s’essuya le front de son avant-bras. Il avait passé. Il rangea le couteau à boyaux et pénétra à mains nues dans les restes graisseux de l’intérieur de la sixième vache. »
On est extrêmement étonné quand on croise tout à coup parmi les employés de l’abattoir Ambrosio, l’Espagnol qui prenait soin des vaches chez Knuchel ! Qu’a-t-il pu se passer pour que cet ouvrier dévoué à la ferme se retrouve dans cet abattoir ? Que veut nous dire cette ellipse temporelle ? Le roman sera bâti ainsi : il alternera entre les moments à la ferme, dans la verdure de l’alpage, et ceux à l’abattoir, le lecteur cherchant à comprendre ce qui a conduit l’employé modèle en enfer.
Le comble de l’horreur est atteint quand Ambrosio reconnaît parmi les futures victimes la reine de Knuchel, cette vache qu’on respectait, qui s’imposait parmi les autres et suscitait l’envie : Blösch, décharnée, tient à peine sur ses pattes et sera bientôt une carcasse. Comment accepter de participer à sa mort ou d’en être témoin après tout ce qui les a liés ?
L’un des moments les plus difficiles, que je reproduis ici, est celui où l’apprenti se retrouve face à Blösch qui résiste et ne veut pas mourir. Pourquoi ? Est-elle inspirée par le diable ?
« La vache s’agite. Elle résiste, s’obstine, en dépit du trou dans son front. Les rares muscles de son corps se tendent. Elle se tortille.
Je lutte pour mon équilibre.
Car le Seigneur est une ombre sur ta main droite.
Attention, le couteau.
Mon verset de confirmation.
Je sens cette force sous moi.
Le cou veut se dresser et battre comme la nageoire caudale d’un poisson en train de crever.
Je plante ma botte en caoutchouc.
Concentre-toi !
Et je plante mon couteau.
Au premier coup, je rate la carotide, au second aussi, pour ne l’attraper qu’au troisième essai. Le rouge jaillit, expulsé vers la lumière à grands coups de pompe du cœur. Elle a une quantité anormale de…
Sous moi, le tremblement du cou s’accentue.
Un gémissement, un râle tremblant dans la trachée, un frémissement, une forte secousse : d’un bond je me lève.
Loin.
La vache dresse la tête. Tout branle, tremble : elle hisse sa carcasse sur ses pattes de devant, veut se lever.
Les naseaux dégouttant de rouge, elle trompette à travers les abattoirs. Assise, elle dodeline de la tête et du cou, de droite à gauche, de gauche à droite, et une fois encore de droite à gauche.
Je recule.
Le sang s’écoule de sa blessure au cou.
Fierté des cornes. Les bois de la vache.
Je me colle au mur, le couteau de boucher tendu loin de moi.
Et voici que la vache s’affaisse ; au bout de ses forces nerveuses, elle gît dans son sang, épuisée.
Piccolo me fixe.
Tout va bien. Les esprits sont chassés.
Personne n’a interrompu son travail.
C’est Kilchenmann qui avait juste oublié de passer par le trou le long fil de fer à planter dans la moelle.
Trop peu détruite.
Le sang se retire de ma tête.
Je ferme les yeux, glisse, le dos au mur ; accroupi, j’essaie de ne penser à rien. »
Le roman mélange les styles : plutôt classique dans sa narration, il laisse parfois place à un langage plus parlé lorsque l’apprenti s’interroge ou que les employés de l’abattoir se livrent à des discussions au moment de la pause. La forme est souvent plus saccadée, comme ci-dessus, lorsque c’est l’apprenti qui monologue mentalement.
En juin dernier, le grand public semblait découvrir l’existence des vaches à hublot, révélée par une enquête de L214. Et pourtant, à la page 146 de La Vache, on lit :
« Récemment, il était allé à l’hospice vétérinaire, et pour lui montrer quelque chose, le vétérinaire lui avait fait enfiler des bottes spéciales et mettre un tablier de caoutchouc. Et puis il l’avait conduit dans une étable expérimentale. Là, il y avait une jeune vache qui avait une véritable fenêtre sur le côté du ventre, si bien qu’on pouvait voir l’intérieur de la panse : on voyait l’herbe très distinctement.
— Sacré vingt dieux, rigola Knuchel, ces messieurs les docteurs ne savaient donc pas que ce qu’une vache a dans la panse, c’est à peu près ce qu’elle a mangé ? »
Ce roman laisse entendre que les vaches, tout heureuses qu’elles puissent être durant leur élevage dans certaines propriétés (pensée welfariste avant l’heure) ne sont pas là pour faire joli dans les champs et qu’au bout du compte, vaches à lait ou pas, elles mourront rarement de leur belle mort. Mais La Vache dénonce surtout la mécanisation de l’élevage et les conditions sociales des employés d’abattoir, sans éveiller particulièrement de pitié pour ces hommes (c’est un milieu masculin), sans en faire des monstres non plus (bien que l’acceptation d’exercer ce métier, même au fond de la misère, au fond du trou, me semble toujours révoltante et incompréhensible). S’il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre tous les détails de la chaîne d’abattage (section vache, taureau et veau), la lecture de La Vache paraît indispensable, et pas seulement aux convaincus. La viande ne vient pas de nulle part, elle ne pousse pas sous cellophane ; elle a été un être sensible… À vous passer l’envie de steak.
Céline Maltère
La Vache, Beat Sterchi, éditions Zoé, avril 2019 (14 euros).
Article pour Le Salon littéraire
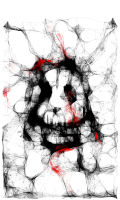
Kashima- Faux-monnayeur
- Nombre de messages : 6546
Date d'inscription : 29/09/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
